

Espace Pédagogique Contributif
Cours de français de m. bruno rigolt – lycée en forêt – montargis (france). ressources pédagogiques en ligne – culture générale, corrigé de dissertation : zola, mauriac, camus. fonctions du roman.
- Entraînement à l’Épreuve Anticipée de Français : dissertation littéraire
- Albert Camus, L’Étranger
- François Mauriac : Thérèse Desqueyroux
- Pour la méthodologie de la dissertation, voir ce support de cours . –
Dissertation littéraire
Sujet corrigé bruno rigolt, rappel du sujet : , émile zola dans le roman expérimental (1880) affirme qu’une œuvre littéraire doit être « un procès-verbal, rien de plus : elle n’a que le mérite de l’observation exacte […] ». ce jugement s’accorde-t-il avec votre lecture de thérèse desqueyroux et de l’étranger .
[Introduction] Elle se compose de trois étapes essentielles : l ’entrée en matière et l’annonce du sujet ; l a définition d’une problématique ; l ’annonce du plan.
_____ En réaction aux écrivains romantiques de la première moitié du XIXe siècle, les romanciers réalistes et naturalistes ont en commun de « dire toute la vérité » selon l’expression bien connue de Maupassant. Fortement marqué par le développement des sciences, Zola définira même le roman selon une méthode indissociable d’une interprétation scientifique et déterministe de la société. C’est ainsi que dans le Roman expérimental , essai paru en 1880, il théorise la doctrine naturaliste en ces termes : « L’œuvre devient un procès-verbal, rien de plus ; elle n’a que le mérite de l’observation exacte […] ».
_____ La sévérité d’un tel jugement prête cependant à discussion : le genre romanesque doit-il se borner à présenter un « reflet » de la société, à en être seulement le « miroir », ou doit-il nourrir d’autres ambitions ? Ces questionnements fondent la problématique de notre travail.
_____ Si le roman, comme nous le concéderons d’abord, est fondé sur une méthode d’observation objective, nous verrons qu’il peut aussi recomposer le réel, notamment par la remise en question de la notion de personnage telle qu’elle a été élaborée auparavant. Il conviendra enfin de dépasser cette dialectique quelque peu réductrice pour envisager une définition plus profonde du genre romanesque : comme moteur de la conscience humaine, le roman ne permettrait-il pas plutôt, loin d’aliéner l’homme au réel, de l’ouvrir au contraire à un questionnement intérieur, questionnement avant tout philosophique et existentiel ? Nous étayerons notre démonstration par les deux œuvres au programme : Thérèse Desqueyroux de François Mauriac et l’Étranger d’Albert Camus.
[Développement] Pour les sujets qui comportent une thèse à discuter, le plan sera évidemment dialectique (thèse validée/discutée/réajustée = certes/mais/en fait).
_____ En premier lieu, il convient de situer le genre romanesque dans le cadre des canons définis par le Naturalisme. Les termes employés par Zola confèrent en effet à l’écriture les caractères d’un « procès-verbal », d’une « observation exacte » de la réalité.
_____ Les deux romans soumis à notre étude relèvent par plusieurs aspects de l’analyse naturaliste. Dans Thérèse Desqueyroux , nous retrouvons par exemple une méthode d’observation des personnages qui les enracine fortement dans un déterminisme social et héréditaire : argent, pouvoir, instinct de propriété les conditionnent au point qu’ils semblent ne pas pouvoir échapper à leur destin. Ainsi Thérèse rêve d’un avenir différent, mais elle ne parviendra jamais à le construire. Son crime est le rêve quelque peu bovaryste d’un ailleurs d’autant plus illusoire qu’elle est littéralement prisonnière du milieu et des circonstances sociales. Jeune bourgeoise provinciale, elle a fait un mariage de convenance : placée sous le signe de l’enfermement et de l’incommunicabilité, sa vie de couple met en relief la banalité de l’existence, dans ce qu’elle a de plus ordinaire et trivial. De même, nous avons l’impression que Camus dans L’Étranger , refusant tout artifice rhétorique, se plaît à détailler jusqu’aux limites extrêmes la condition subalterne et médiocre de Meursault, qui apparaît comme le contraire d’un héros. D’ailleurs, le meurtre de l’Arabe s’inscrit dans une forme de fatalité qui n’est pas sans rappeler, autant le naturalisme et son déterminisme, que le fatum de la tragédie antique. A insi Meursault voit-il constamment le destin lui échapper : le meurtre de même que la condamnation à mort semblent conditionnés par une existence dérisoire et absurde, vécue dans une passivité et une immédiateté dépourvues de profondeur. Cette existence banale est parfaitement rendue comme l’a souligné Roland Barthes, par l’écriture blanche du roman, dépouillée dans son lexique et sa syntaxe.
_____ En outre, nous pouvons noter dans les deux œuvres un refus d’idéaliser le réel. De même que Zola n’économise dans ses romans aucun détail horrible, quitte à choquer par son souci d’être vrai les lecteurs et le « bon goût », Mauriac multiplie les remarques sur le conservatisme politique et social qui règne à Argelouse. Supprimant tout suspens dramatique, l’auteur a restitué le climat oppressant d’une classe sociale soucieuse avant tout de sa réputation. Cette trahison du spirituel est bien rendue par Bernard Desqueyroux : homme d’habitude et de principes, il organise sa vie selon un plan méthodique qui en dit long sur les préjugés de son milieu. De même, Balion, Balionte et Gardère, les domestiques, sont décrits sans concession dans toute leur petitesse et leur médiocrité humaine. Avec une ironie féroce, l’auteur dresse ainsi le « procès-verbal » de cette société du simulacre et de la dissimulation. Camus peint également sans idéalisation l’âpre réalité de la condition humaine : témoin le regard mécanique et froidement informatif que Meursault porte sur les pensionnaires de l’hospice de Marengo, sur la scène de l’enterrement ou le déroulement du crime. Ce parti pris de réalisme se retrouve dans le misérabilisme des situations : Salamano, le voisin de palier de Meursault, promenant son chien qu’il insulte souvent « le long de la rue de Lyon » selon un itinéraire qui n’a pas changé depuis huit ans. Nous pourrions évoquer aussi les accents pétainistes des discours de la Cour lors du procès ou les « cris de haine » de la foule préfigurant à la fin du roman l’exécution capitale. Dans ce monde obscur et lourd, c’est bien la morale des apparences sociales qui domine.
_____ Cette observation de la vie réelle dans ce qu’elle a de plus trivial parfois confère aux deux romans un caractère réaliste assez marqué qui conduit à une vision pessimiste du monde : ainsi, la société condamne Thérèse et Meursault tous deux pour avoir refusé de « jouer le jeu » pour reprendre la célèbre formule camusienne dans la préface à l’édition américaine de L’Étranger : dans leur refus même, et malgré leur acte criminel, ils trouvent la dignité et une sorte de salut. Loin du simulacre du monde et de la tentation de chercher refuge et facilité dans le mensonge, le réalisme de leur crime oblige en effet à voir la réalité en face, à ne pas la dissimuler derrière le masque trompeur des apparences et de la médiocrité. L es auteurs examinent les personnes de la réalité, font l’étude des interactions entre l’individu et son milieu afin de montrer la vérité en face : il s’agit de la peinture de l’existence décrite de façon prosaïque, loin de toute transcendance divine ou morale. Meursault est bien un antihéros qui refuse « d’avoir une apparence ou un langage qui trahiraient son être », selon le commentaire de Camus lui-même. On trouve ainsi chez les deux romanciers une évocation très crue de la mort, qu’il s’agisse de l’incipit célèbre de L’Étranger ou des détails sordides de l’empoisonnement chez Mauriac : « Thérèse pourrait réciter la formule inscrite sur l’enveloppe et que l’homme déchiffre d’une voix coupante : Chloroforme : 30 grammes. Aconitine granules n° 20. Digitaline sol. : 20 grammes ». Comme nous le comprenons, le réalisme dont il est question ne doit pas être confondu avec de simples effets de réel : il s’agit plus fondamentalement de peindre un antihéros écrasé par les déterminismes aliénants et de mettre en évidence la loi inexorable des rapports de force et de l’agencement du monde.
[Déduction générale] _____ Ainsi que nous avons cherché à le montrer, les personnages de Thérèse et de Meursault n’assument pas de fonction irréalisante ou même idéalisante. Loin de nier le réel pour lui substituer l’imaginaire ou la quête transcendante, ils s’enracinent au contraire dans l’histoire et l’espace déterministe dans lequel ils vivent : leur drame est précisément de ne pouvoir s’échapper de ce destin imposé que par l’exil ou la mort.
[Transition] _____ Pour autant, on aurait tort de réduire Thérèse Desqueyroux et l’Étranger à deux romans « d’observation ». Si le projet scientifique de Zola est bien de peindre des êtres seulement « déterminés », c’est-à-dire définis et gouvernés par leur hérédité, leur milieu social et les circonstances qu’ils traversent, Mauriac et Camus dans leur négation de l’histoire comme absolu et dans leur refus des idéologies, donnent au contraire à leur personnage une épaisseur psychologique et humaine qui dépasse largement le cadre de la reproduction exacte de la vie.
[Antithèse]
_____ L’œuvre littéraire, contrairement à ce qu’affirme Zola, n’a pas seulement pour but l’observation exacte : au contraire, la fiction peut chercher à contester une vision du monde donnée a priori . Loin de la neutralité du procès-verbal, « la création, comme l’écrit Camus dans L’Homme révolté , est exigence d’unité et refus du monde. Mais elle refuse le monde à cause de ce qui lui manque et au nom de ce que, parfois, il est ». Si le réel est donc nécessaire à l’art, la création propose un nouveau monde qui passe par une esthétique de la révolte ; révolte artistique et métaphysique contre l’absurdité et le non-sens.
_____ Il convient de noter pour commencer combien l’écriture chez Mauriac et Camus est profondément déstabilisatrice : loin de viser à « l’observation », elle cherche plutôt la contestation du romanesque traditionnel : si Roland Barthes que nous évoquions précédemment voit dans l’écriture de l’Étranger un « style de l’absence », c’est que le je de la narration, en échappant précisément au narrateur lui-même, libère le récit de toute rationalité. D’où cette « parole du silence » chez Meursault, « transparente aux choses et opaque aux significations ». Comme l’a bien montré Jean-Paul Sartre, l’hermétisme des émotions conduit le lecteur au sentiment de l’absurde, par le fait même qu’elle le contraint à prendre ses distances avec l’histoire racontée. Ce qui est en effet surprenant dans ce roman tient au fait que, si la façon d’écrire pourrait faire penser parfois à un journal intime, l’absence de toute affectivité, de toute implication émotionnelle, remet en cause l’identification du lecteur au héros. De même, dans Thérèse Desqueyroux , le récit souvent lacunaire fait perdre au lecteur ses repères : la longue analepse sous forme de monologue intérieur qui domine dans la première partie du roman, loin de guider le lecteur vers la résolution d’un problème, le perd au contraire dans l’attente, la réflexion sur la mort et la culpabilité : la place du monologue intérieur ainsi que la technique de l’analepse sont donc bien loin des enquêtes de Zola, entièrement soumises à l’« expérimentation scientifique » : délaissant volontairement le réalisme objectif de l’affaire Henriette Canaby, Mauriac nous plonge davantage dans la subjectivité du personnage. Comme il le dira lui-même, « J’ai emprunté […] les circonstances matérielles de l’empoisonnement mais je n’ai pris qu’une silhouette ».
_____ D’ailleurs, Il n’y a pas vraiment de schéma actantiel dans les deux romans : pas de quête suivie, pas d’objet, pas d’état final définitif, et nous pourrions appliquer à Thérèse ce que Camus dit à propos de Meursault : « le héros du livre est condamné parce qu’il ne joue pas le jeu. En ce sens, il est étranger à la société où il vit, il erre, en marge ». Dans leur exigence d’authenticité, Meursault ou Thérèse ne « jouent » pas la « comédie humaine » ou plutôt « l’inhumaine comédie » : ils ne luttent pas, ils ne se battent pas. Leur drame est donc de refuser le réel qui leur est proposé pour s’enfoncer plus encore dans la banalité transgressive de leur quotidien. Aucune individualité typisée chez ces personnages hors-norme : même leur crime semble dénué d’enjeu. Maurice Maucuer faisait à ce titre remarquer très justement : « On peut donc penser que ce refus d’insérer l’action romanesque dans le déroulement d’événements historiques précis, que ce parti pris d’annuler l’histoire […] traduisent sans doute la volonté de peindre, sans s’arrêter aux particularités d’une époque, une vérité humaine qui est de tous les temps » (Maurice Maucuer, Thérèse Desqueyroux , éd. Hatier, coll. Profil d’une œuvre, p. 28) . Pareillement, Meursault ne semble pas avoir d’identité ou de fonction sociale clairement marquée : comme dans le poème de Baudelaire intitulé « L’étranger », l’aspect énigmatique et anticonformiste du personnage est rendu par ses réponses, plus déroutantes les unes que les autres, et qui lui confèrent une sorte d’hermétisme. Au statut de marginal dans le poème répond l’anonymat d’un petit employé algérois sans importance : c’est là le paradoxe de ces personnages « indéchiffrables » voués au silence et à l’incompréhension.
_____ Ce refus d’ancrage référentiel est bien sûr irréductible au réalisme tel que le conçoit Émile Zola. Pour l’auteur de Germinal , le roman doit raconter la lutte du capital contre le travail. Ainsi, d’un point de vue narratif par exemple, les étapes du conflit entre les mineurs et le patronat rythment la progression du récit et font monter la tension dramatique. Dans nos deux romans au contraire, tout semble joué d’avance au point qu’il n’y a pas vraiment d’énigme. De même Thérèse et Meursault ne répondent pas à la caractérisation du personnage telle que l’envisagent les romanciers réalistes. Loin de donner à son héros une identité crédible et significative, Camus refuse par exemple le point de vue omniscient qui permettrait de dévoiler le passé de Meursault, de révéler ses pensées, en somme d’organiser un portrait détaillé. S’il assiste à l’enterrement de sa mère sans verser de larmes, s’il accepte avec indifférence la demande en mariage de Marie, s’il ne fait preuve d’aucun remords pendant les onze mois que dure l’instruction, c’est non parce qu’il est ce « monstre », ce criminel au « cœur endurci » que décrira le procureur lors du procès, mais parce qu’il refuse, dans une attitude de « défi », de se plier au « jeu » du monde. En ce sens, il est tout sauf le représentant d’une catégorie sociale. De même, il n’y a pas de type romanesque chez Thérèse au sens défini par Balzac : « Un type […] est un personnage qui résume en lui-même les traits caractéristiques de tous ceux qui lui ressemblent plus ou moins, il est le modèle du genre » . Point de « modèle » donc chez ces personnages hors-norme, irréductibles à toute caractérisation objective.
[Déduction générale] _____ Alors que le héros réaliste est confronté à une réalité impitoyable face à laquelle il doit déployer son énergie pour survivre ou s’élever, le personnage chez Mauriac et Camus est donc l’expression d’une crise existentielle et identitaire majeure au point qu’on pourrait parler de « mort du personnage » dans les deux romans. Devenue « opaque » sous le regard d’une conscience indéchiffrable, la conscience du personnage présente un aspect énigmatique, voire hermétique.
[Transition] _____ Parvenus à ce stade de la réflexion, il convient de s’interroger : faut-il envisager le roman, et plus particulièrement le personnage, uniquement sous l’angle du projet réaliste ? Ne peut-on lire L’Étranger ou Thérèse Desqueyroux comme des romans de l’énigme de soi ? Tout l’intérêt de l’écriture fictionnelle à partir du vingtième siècle a été précisément de renouveler la fonction de l’écrivain : à l’ enquête chère à Zola, nos deux romans privilégient davantage la quête : quête intérieure indissociable d’un profond questionnement existentiel.
_____ Si observation de la réalité il y a, chez Mauriac et Camus c’est une observation du moi le plus intime du personnage, c’est-à-dire l’expression d’un monde intérieur. Point de départ d’une réflexion sur le sens de la vie, le thème de la mort, omniprésent dans les deux œuvres, débouche sur une méditation philosophique essentielle : pourquoi vivre si c’est pour mourir, pourrait dire Camus ? De même, dans Thérèse Desqueyroux , le roman invite le lecteur, grâce au monologue intérieur, à une pratique de l’introspection.
_____ De fait, il faut lire d’abord nos deux œuvres comme des romans humanistes qui renvoient à une souffrance de l’être. Romans humanistes mais aussi romans philosophiques : Camus disait justement qu’« un roman n’est jamais qu’une philosophie mise en images », et il est certain qu’en montrant des comportements dépourvus de signification, L’Étranger est révélateur d’une interrogation sur le sens de la vie, déjà esquissée dans Le Mythe de Sisyphe : « Dans cet univers indéchiffrable et limité, le destin de l’homme prend désormais son sens. Un peuple d’irrationnels s’est dressé et l’entoure jusqu’à sa fin dernière. Dans sa clairvoyance revenue et maintenant concertée, le sentiment de l’absurde s’éclaire et se précise. Je disais que le monde est absurde et j’allais trop vite. Ce monde en lui-même n’est pas raisonnable, c’est tout ce qu’on en peut dire. Mais ce qui est absurde, c’est la confrontation de cet irrationnel et de ce désir éperdu de clarté dont l’appel résonne au plus profond de l’homme ». Plus simplement Camus définira l’absurde comme le « divorce entre l’homme et sa vie ». C’est de cette « confrontation entre l’appel humain et le silence déraisonnable du monde » que naît le sentiment de l’absurde. Ainsi, l’Étranger comme Thérèse Desqueyroux d’ailleurs ne se réduit pas à un contenu narratif : il est d’abord un roman sur la quête d’authenticité. Le but en effet est de nous amener à trouver dans l’existence la nostalgie d’une vérité « profondément humaine » : l’homme peut tromper les autres mais il ne peut se tromper lui-même. Dans le Mythe de Sisyphe , Camus écrivait à ce titre : « La divine disponibilité du condamné à mort devant qui s’ouvrent les portes de la prison par une certaine petite aube, cet incroyable désintéressement à l’égard de tout, sauf de la flamme pure de la vie, la mort et l’absurde sont ici, on le sent bien, les principes de la seule liberté raisonnable : celle qu’un cœur humain peut éprouver et vivre ».
_____ Ces propos, on le pressent, sont de la plus haute importance : prendre conscience de l’absurde pour Camus est presque une obligation morale ; c’est ainsi sauvegarder sa liberté en retrouvant le rapport d’unité à soi-même et au monde. De façon similaire, le crime de Thérèse est une mise en cause de la vie dans ce qu’elle a de plus trivial : vie médiocre, dépourvue de sens, qui aliène à soi-même. Romans de l’incommunicabilité, Thérèse Desqueyroux et l’Étranger sont aussi des romans du silence, du non-dit, de l’ellipse. Dans le monde du simulacre qu’ils cherchent à fuir, il n’y a de place que pour le mensonge, la dissimulation, l’hypocrisie sociale ; et sans doute comprenons-nous mieux la révolte de Meursault à la fin du roman lorsqu’il évoque sa mère : « personne n’avait le droit de pleurer sur elle ». Ce mot « personne » englobe les autres, mais aussi Meursault lui-même, qui se révèle alors celui qui a refusé de pleurer, comme les autres auraient voulu qu’il pleurât pour se conformer aux usages. La révolte de Meursault n’est donc pas une révolte politique au sens où l’entendait Zola : c’est davantage une révolte métaphysique contre les conventions sociales. Pareillement, le personnage de Thérèse ne se limite pas au portrait d’une criminelle. Loin de nous livrer le personnage une fois pour toutes, Mauriac par le truchement de la « remontée des souvenirs », nous présente au contraire un personnage complexe, contradictoire : par son refus de se soustraire à la vacuité du monde, il s’y confronte : le crime apparaît ainsi comme une révolte contre une société prisonnière des préséances et des simulacres odieux. Thérèse et Meursault doivent donc disparaître, seule manière pour l’homme de donner du sens à sa vie dans un monde neutre, un monde qui a cessé d’avoir un sens, où les valeurs sont détruites. La mort n’est plus vécue comme négation mais comme révolte de l’homme contre sa condition, en faisant face jusqu’au bout au nihilisme.
_____ Ce refus d’élever le héros de roman au mythe est essentiel. Alors que dans Germinal par exemple, le réalisme de Zola débouche sur une grande fresque historique qui implique une simplification constante des personnages, nos deux romans présentent au contraire des êtres soumis au resserrement temporel et spatial qui est celui des tragédies. Cette atmosphère de huis-clos, en bousculant perpétuellement notre horizon d’attente, oblige à pénétrer l’univers subjectif du héros, et donc à pénétrer dans l’atelier de fabrication du roman : jusqu’à quel point le romancier est-il maître de ses personnages ? Que pense vraiment Meursault ? Est-il possible, quoi que nous fassions, de sonder les profondeurs de l’âme de Thérèse ? Tous deux nous amènent à réfléchir sur nous-même et à nous questionner : de même que Meursault à la fin du roman renonce à donner un sens illusoire à sa vie, Thérèse refuse d’expliquer rationnellement son geste. La complexité du roman ne repose-t-elle pas en grande partie sur la complexité intérieure du personnage ? Complexité bien plus grande encore que le personnage social. Comme l’écrira Mauriac dans Le Roman , « Il s’agit de laisser à nos héros l’illogisme, l’indétermination, la complexité des êtres vivants », donc « laisser aux personnages l’indétermination et le mystère de la vie ». Alors que le roman réaliste va de l’énigme à sa résolution, nos deux romans vont à l’opposé du geste à l’énigme. L’exploration du personnage débouche ainsi sur son propre mystère. En acceptant l’exécution finale, Meursault accepte d’être le bouc émissaire d’une société profondément absurde, déclarant un homme coupable pour la seule raison qu’on ne l’a pas vu pleurer à l’enterrement de sa mère. Il devient ainsi véritablement libre en acceptant le jugement dernier comme une « grâce » qui préfigure obscurément l’espérance et le salut du monde. De même, l’épilogue de Thérèse Desqueyroux peut se lire selon un sens profondément spirituel. Incapable de fournir à Bernard un mobile précis pour justifier son crime, la jeune femme affirme : « Il se pourrait que ce fût pour voir dans vos yeux une inquiétude, une curiosité, du trouble enfin ». Le champ philosophique dans les deux œuvres est donc celui du déchiffrement : le roman transforme ainsi une interrogation sur le réel en questionnement existentiel.
[Déduction générale] ____ Ambiguïté et complexité des personnages vont donc de pair chez Mauriac et Camus qui s’emploient à questionner nos préjugés de lecteur : entre attirance et recul, nous sommes contraints de rentrer dans la subjectivité des personnages , et d’envisager le roman sous l’angle de l’examen de conscience : derrière la figure sulfureuse d’une empoisonneuse ou d’un « barbare » sans remords « étranger » aux hommes mais ouvert « à la tendre indifférence du monde », il faut chercher une valeur symbolique qui est de nous pousser à trouver un sens existentiel à la vie : ainsi les deux romans peuvent s’interpréter comme une quête de conscience morale, symbolisée par « cette nuit chargée de signes et d’étoiles », sur laquelle s’achève L’Étranger .
[Conclusion] Elle se doit d’être brève et synthétique. Elle comporte en général deux étapes : l e bilan ; l ’ouverture (ou élargissement).
_____ L’exploration du personnage est l’un des mystères sans cesse renouvelé de la complexité du roman. Si les propos d’Émile Zola, en faisant l’apologie de la réalité objective, limitent le travail de l’écrivain à l’observation sociale, il faut reconnaître que tout l’intérêt de L’Étranger et de Thérèse Desqueyroux est d’amener le lecteur, bien au-delà de l’histoire racontée qui nous conduirait de prime abord à condamner deux criminels, à un profond questionnement intérieur.
_____ À la trivialité des récits, qui par plusieurs aspects rappelle les querelles et débats soulevés par le Naturalisme, les deux romans mettent donc en évidence une vision profondément contradictoire et complexe de l’être humain. Ainsi, le réel ne suffit point à l’homme pour trouver du sens. Le but du roman n’est-il pas justement de nous confronter à l’indicible ? En cela, il fait émerger un profond message humain, chargé de nous faire entrevoir le bonheur dans l’opacité du monde…
Bruno Rigolt © mars 2018, Bruno Rigolt/Espace Pédagogique Contributif

J’aime ça :
brunorigolt
- Agrégé de Lettres modernes - Docteur ès Lettres et Sciences Humaines (Prix de Thèse de la Chancellerie des Universités de Paris) - Diplômé d’Etudes approfondies en Littérature française - Diplômé d’Etudes approfondies en Sociologie - Maître de Sciences Politiques Voir tous les articles par brunorigolt
En savoir plus sur Espace Pédagogique Contributif
Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.
Saisissez votre adresse e-mail…
Abonnez-vous
Continue reading
Exemple de dissertation pour le bac de français !
Tu passes le bac de français ? CLIQUE ICI et deviens membre de commentairecompose.fr ! Tu accèderas gratuitement à tout le contenu du site et à mes meilleures astuces en vidéo.
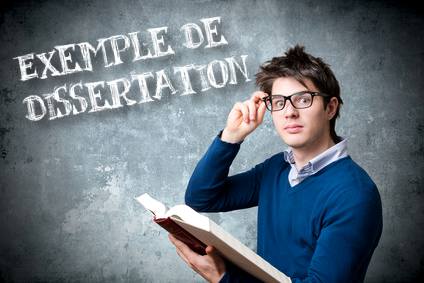
Tu trouveras sur cette page :
- Des exemples de sujets de dissertation sur chaque œuvre au programme.
- Un exemple de dissertation entièrement rédigée selon les exigences du bac de français.
Pour bien traiter ces sujets, aide-toi de ma méthode de la dissertation qui te montre comment organiser tes idées et construire ta copie.
Exemples de dissertation sur chaque œuvre au programme
- Selon vous, est-ce l’immoralité du personnage de Manon Lescaut qui fait le plaisir de la lecture du roman ? (Voir la dissertation rédigée sur Manon Lescaut )
- Selon vous, le roman de La Peau de chagrin nous invite-t-il à économiser notre énergie vitale ? (Voir la dissertation rédigée sur La Peau de chagrin )
- Selon vous, Dans Sido et Les Vrilles de la vigne , Colette ne célèbre-t-elle que les êtres qu’elle a chéris ? (Voir la dissertation rédigée sur Sido et Les Vrilles de la vigne )
- La liberté créatrice d’Arthur Rimbaud dans les Cahiers de Douai se réduit-elle simplement à une rébellion adolescente ? (Voir la dissertation rédigée sur Cahiers de Douai )
- En quoi La Rage de l’expression de Francis Ponge oeut-il être considéré comme un recueil en cours d’élaboration ? (Voir la dissertation rédigée sur La Rage de l’expression )
- Dans quelle mesure la nature résonne-t-elle avec l’intime dans le recueil Mes Forêts ? (Voir la dissertation rédigée sur Mes forêts )
- Rabelais, dans le « Prologue » de Gargantua , évoque les silènes, boîtes décorées « à plaisir pour exciter le monde à rire » mais contenant diverses « choses précieuses ». En quoi cette image éclaire-t-elle votre lecture de Gargantua ? (Voir la dissertation rédigée sur Gargantua )
- En quoi, dans les livres V à X des Caractères , l’art de la mise en scène sert-il le projet du moraliste ? (Voir la dissertation rédigée sur Les Caractères )
- Lors de sa défense devant le tribunal révolutionnaire en 1793, Olympe de Gouges déclare qu’elle s’est « frayé une route nouvelle ». Comment cette affirmation éclaire-t-elle votre lecture de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne ? (Voir la dissertation rédigée sur la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne )
- L’étymologie grecque du mot crise, Krisis , vient du verbe krinein qui signifie discerner, juger, décider. En quoi cette étymologie éclaire-t-elle votre lecture de Juste la fin du monde ? (Voir la dissertation sur Juste la fin du monde . Tu peux peux lire ci-dessous la dissertation intégralement rédigée comme tu dois le faire le jour J)
- L’écrivain Robert Sabatier définit ainsi la comédie : « On appelle comédie la tragédie envisagée d’un point de vue humoristique. » Cette définition vous paraît-elle s’appliquer au Malade imaginaire ? (Voir la dissertation sur Le Malade imaginaire )
- Selon vous, quel rapport le mensonge entretient-il avec la vérité dans Les Fausses confidences de Marivaux ? (Voir la dissertation sur Les Fausses confidences )
Exemple de dissertation rédigée pour le bac de français
Voici un exemple de dissertation entièrement rédigée , comme tu devras le faire le jour du bac.
L’étymologie grecque du mot crise, Krisis , vient du verbe krinein qui signifie discerner, juger, décider. En quoi cette étymologie éclaire-t-elle votre lecture de Juste la fin du monde ?
(introduction)
La crise est un moment de transition chaotique, souvent douloureux, qui sépare deux périodes d’équilibre. Elle implique tension, discorde, rupture. La « crise » est d’ailleurs profondément liée au genre théâtral puisque toute pièce met en scène le passage d’un nœud dramatique à un dénouement. Juste la fin du monde n’échappe pas à cette règle puisque Jean-Luc Lagarce nous invite au spectacle d’une crise personnelle et familiale à son apogée. Mais le mot « crise » vient aussi du grec Krisis qui signifie décision, jugement et désigne un moment crucial d’arbitrage. En quoi cette étymologie permet-elle d’éclairer la lecture de Juste la fin du monde ? Qui juge et arbitre dans cette pièce ? Quelle instance décisionnelle préside aux choix des personnages ? Nous verrons comment le moment de chaos que constitue la crise dévoile les véritables responsables des décisions qui sont prises dans l’oeuvre de Jean-Luc Lagarce : la famille et l’individu, mais surtout le destin et ses lois inexorables.
(1re partie) Juste la fin du monde met en scène une crise personnelle et familiale. Le spectateur est invité tout d’abord à la tragédie personnelle de Louis, le personnage principal. Dès le prologue, il annonce sa mort prochaine : « Plus tard, l’année d’après / J’allais mourir à mon tour ». Le nœud de l’action ne réside pas dans la maladie de Louis – le personnage se sait condamné et le dénouement est connu d’avance par le spectateur – mais dans son aveu : parviendra-t-il à dévoiler ce douloureux secret ? Son mal-être est perceptible dès le début de la pièce car sa révélation est difficile : « C’est pénible, ce n’est pas bien / Je suis mal à l’aise. / (…) mais tu m’as mis mal à l’aise et là, / maintenant, / je suis mal à l’aise. » (Partie I, scène 2). Les épanorthoses (Louis revient sans cesse sur ses termes pour les nuancer) et la structure en chiasme (ABBA) de ses phrases révèlent son enferment dans une crise intérieure dont il ne parvient pas à se libérer. En cela, Jean-Luc Lagarce crée un parallèle avec Phèdre de Jean Racine dans laquelle l’aveu de l’héroïne éponyme est au centre de la tragédie. Dans les tragédies classiques, le héros est en proie à des passions violentes contre lesquelles il ne peut pas lutter : c’est la révélation de ses passions qui crée le chaos. C’est ce qui arrive à Louis : sa maladie est déjà là au début de la pièce. Impuissant, il ne lui reste plus qu’à la révéler à son entourage. Louis vit donc deux tragédies simultanées : son combat contre la mort et sa difficulté à avouer ce combat. À l’image de Phèdre, son déchirement intérieur en fait un modèle de héros tragique en pleine situation critique.
Au-delà de la crise personnelle de Louis, c’est tout l’édifice familial qui est placé dans une situation de crise. Le retour de Louis bouleverse en effet l’équilibre familial et réveille les souffrances de chaque membre de la famille. Pour la mère, le retour de Louis correspond au retour du fils prodigue, écrivain, dont on n’a jamais vraiment compris le départ. Pour Antoine, c’est le retour du frère aîné rival, celui qui réactive ses complexes, ses passions et sa jalousie. Pour Catherine et Suzanne, Louis est un miroir qui les confronte à la médiocrité et à la banalité de leur vie. La crise familiale s’exprime violemment, au travers de disputes constantes. Ainsi, tous les personnages se querellent : Antoine et Catherine, Antoine et Suzanne, Suzanne et Catherine, la mère et ses enfants. La violence la plus spectaculaire est celle d’Antoine qui fait éclater la rivalité fraternelle au grand jour dans la scène 2 de la deuxième partie : « ANTOINE : Tu me touches : je te tues ». L’asyndète (absence de liaison entre les deux propositions) accentue la violence du propos et le caractère dramatique de cette scène où la famille, au paroxysme de la crise, se déchire sous nos yeux.
Juste la fin du monde met donc en scène deux crises distinctes : la crise personnelle de Louis et la crise familiale provoquée par son retour. Comme son étymologie grecque krisis l’indique, la crise désigne aussi un moment décisif d’arbitrage. Et l’on voit justement dans cette pièce des mécanismes se mettre en place pour arbitrer la sortie de crise.
(2e partie)
Afin de rétablir l’équilibre, la famille de Louis et Louis lui-même opèrent des choix. Le retour de Louis, après douze ans d’absence, provoque une véritable crise dans le foyer. Immédiatement, un tribunal familial se met en place pour juger le frère aîné. Ainsi, le champ lexical du droit abonde dans le texte. Catherine dit elle-même : « je ne voudrais pas avoir l’air de vous faire un mauvais procès ». Louis accepte d’endosser la culpabilité : « et ces crimes que je ne me connais pas, je les regrette, j’en éprouve du remords « (2ème partie, scène 1). Ce tribunal familial ne s’en prend pas qu’à Louis et juge tour à tour les personnages. Ainsi, Antoine est également accusé d’être « brutal » dans la scène 2 de la deuxième partie et c’est Louis qui le défend comme le ferait un avocat : « Non il n’a pas été brutal ». La scène devient donc une juridiction dans laquelle chaque personnage se retrouve sur le banc des accusés. De ce point de vue, Juste la fin du monde fait songer à la pièce Huis-clos de Sartre où les personnages, enfermés dans une même pièce après leur mort, se jugent les uns les autres. Mais le verdict final de ce tribunal domestique conduit à rejeter Louis hors du cercle familial. Ainsi, dans la scène 3 de la deuxième partie, les personnages féminins sont gagnés par l’immobilité et s’effacent devant la confrontation des deux frères : « LA MÈRE : Nous ne bougeons presque plus, nous sommes toutes les trois, comme absentes, on les regarde, on se tait. » Le silence qui règne jusqu’à la fin de la scène suggère leur adhésion au discours d’Antoine et une rupture complète entre Louis et sa famille.
La pièce peut aussi se lire comme la représentation d’une cure psychanalytique qui mène Louis à sa décision finale, annoncée dans l’épilogue : « Je pars / je ne reviens plus jamais ». Selon Freud, trois instances sont présentes chez l’homme : le moi qui assure la stabilité et le contact avec la réalité extérieure, le ça, lieu de pulsions qui ne supporte pas la contradiction, et le surmoi, instance morale qui rappelle les interdits. Les personnages de la pièce semblent symboliser ces trois éléments : la Mère serait une sorte de surmoi (l’instance morale), Antoine le ça (les pulsions) et Louis l’inconscient qui ne parvient pas à émerger et dire la mort. Le jeu sur les temps (« je suis touché, j’ai été touché » 1re partie, scène 2) suggère une introspection dans le passé, comme cela se pratique lors d’une psychanalyse. La multiplication des épanorthoses fait penser à une parole analytique qui se cherche pour découvrir une vérité intérieure. On pourrait ainsi rapprocher Juste la fin du monde du théâtre de Nathalie Sarraute qui joue sur les codes de la psychanalyse pour en faire une aventure esthétique et littéraire. Comme Nathalie Sarraute, Jean-Luc Lagarce s’attache à saisir les non-dits et les sentiments cachés derrière l’apparente banalité des conventions sociales. Ainsi, dans la scène de retrouvailles (partie I, scène 1), des sentiments de gêne, de rejet tacite et d’hésitation se devinent derrière les phrases stéréotypées et le masque pesant des politesses : « SUZANNE : C’est Catherine. / Elle est Catherine. / Catherine, c’est Louis. / Voilà Louis. / Catherine. »
Les personnages prennent des décisions pour juguler la crise. Mais sont-ils réellement maîtres de leur destin ? Le dénouement de la crise n’est-il pa connu d’avance ?
(3e partie)
Juste la fin du monde montre avant tout que seul le destin décide véritablement, les personnages étabt soumis à une autorité supérieure qui leur échappe. Le destin est la véritable instance décisionnelle de la pièce. Louis est d’abord soumis à un destin biologique : celui de la maladie. Celle-ci est presque invisible – Louis ne parvient pas à en parler – mais elle est la véritable maîtresse du jeu qui agit sur les personnages. Elle est d’ailleurs évoquée au début de l’œuvre, dans le Prologue (« J’allais mourir à mon tour ») et à la fin, dans l’Epilogue (« Je meurs quelques mois plus tard »), dans une circularité parfaite. La maladie incarne la fatalité tragique inéluctable qui scelle le destin du personnage. Elle remporte le combat inégal et perdu d’avance par Louis. Le destin auquel est soumis le personnage est également héréditaire. On découvre que trois hommes de trois générations successives portent le prénom de Louis. Jean-Luc Lagarce joue sur la récurrence de ce prénom pour inscrire son personnage principal dans une lignée tragique qui fait songer à la malédiction des Atrides dans la mythologie grecque. La crise familiale semble donc être inscrite dans un continuum qui sous-entend que le destin des personnages est écrit d’avance, comme dans les tragédies. C’est en outre ce que suggère Louis dans la scène 1 de la deuxième partie : « C’est exactement ainsi, / lorsque j’y réfléchis, / que j’avais imaginé les choses ».
Soumis à un destin qui leur échappe, les personnages sont également emportés dans une crise collective d’un monde qui ne parvient plus à fonctionner. Le titre Juste la fin du monde invite d’ailleurs les spectateurs à être les témoins d’un monde en crise. L’expression « la fin du monde » fait allusion à une apocalypse collective tandis que l’adverbe « juste » dévoile l’ironie d’un auteur qui observe ce chaos avec distance et humour. Tout comme Louis qui assiste, impuissant, à la crise familiale, le spectateur est invité à regarder l’état de crise permanent dans lequel sont plongés les membres de cette famille. Car si la crise intérieure de Louis, due à sa maladie, suscite la compassion, qu’en est-il de l’obsession psychologique des autres personnages qui se disputent sur chaque mot ? Pris dans un culte de la complication, une recherche de la crise pour la crise, les personnages passent à côté de l’essentiel. Jean-Luc Lagarce montre ainsi un monde où tout se délite : les valeurs, la famille, le langage. Les dialogues des personnages ressemblent d’ailleurs parfois à ceux du théâtre de l’absurde, tel l’échange banal entre Louis et Antoine qui rappelle les échanges mécaniques entre Vladimir et Estragon dans En attendant Godot de Beckett : « Je vais bien / Je n’ai pas de voiture, non / Toi comment est-ce que tu vas ? ANTOINE Je vais bien. Toi comment est-ce que tu vas ? » (1re partie, scène 1).
(conclusion)
Juste la fin du monde est bien un drame de la crise : la crise personnelle et familiale est dénouée par une décision familiale tacite et une introspection personnelle qui poussent Louis à quitter sa famille, sans révéler son secret. Mais la pièce dévoile surtout la crise d’un monde désagrégé qui conduit à la désunion de tout, des êtres, des choses, des valeurs et de langage. La crise des personnages est une fenêtre par laquelle apparaît l’effondrement d’un monde comme on peut le voir chez un dramaturge comme Bernard-Marie Koltès dont le théâtre exprime la tragédie de l’être solitaire et de la mort.
Tu t’entraînes à la dissertation ? Regarde aussi :
♦ Comment analyser un sujet de dissertation ♦ L’introduction de la dissertation (méthode) ♦ La conclusion de la dissertation (méthode) ♦ Le plan de ta dissertation
Dissertations sur les anciennes oeuvres au programme
♦ Exemple de dissertation sur La Princesse de Clèves ♦ Exemple de dissertation sur Le Rouge et le Noir ♦ Exemple de dissertation sur Mémoires d’Hadrien

Les 3 vidéos préférées des élèves :
- La technique INCONTOURNABLE pour faire décoller tes notes en commentaire [vidéo]
- Quel sujet choisir au bac de français ? [vidéo]
- Comment trouver un plan de dissertation ? [vidéo]
Tu entres en Première ?
Commande ton livre 2024 en cliquant ici ⇓.
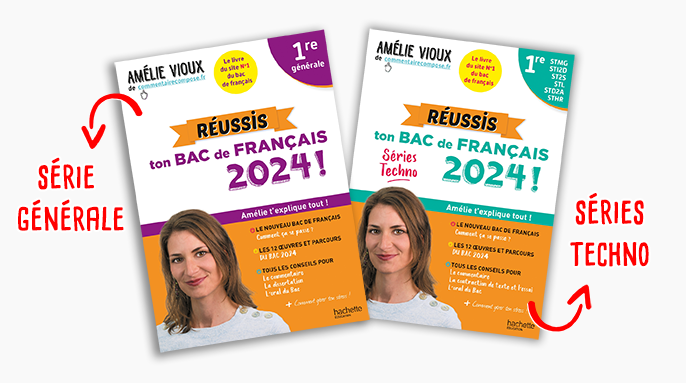
Qui suis-je ?
Amélie Vioux
Je suis professeur particulier spécialisée dans la préparation du bac de français (2nde et 1re).
Sur mon site, tu trouveras des analyses, cours et conseils simples, directs, et facilement applicables pour augmenter tes notes en 2-3 semaines.
Je crée des formations en ligne sur commentairecompose.fr depuis 12 ans.
Tu peux également retrouver mes conseils dans mon livre Réussis ton bac de français 2024 aux éditions Hachette.
J'ai également publié une version de ce livre pour les séries technologiques ici.
62 commentaires
Bonjour Amélie, J’ai arrêté l’école il y a plusieurs années… Je n’ai pas le niveau lycée et j’aimerais savoir si vos cours suffiront pour passer le bac es de français en tant que candidat libre ?
Bonjour Abid, Mes cours et formations sont adaptées pour les lycéens qui passent le bac de français. Si tu es en reprise d’étude pour passer le baccalauréat, mes cours te seront donc bien utiles !
Bonsoir Mme Vioux, merci pour cette page, elle me sera très utile, cependant, avez-vous le corrigé de la dissertation sur LaFontaine s’il-vous-plaît ?
c’est un seul paragraphe dans l’intro, un paragraphe dans la conclusion.
Bonjour, c’est la première fois que je dois faire une dissertation et je ne sais pas comment m’y prendre .Pourriez vous m’aider ? La plus grande gloire n’est pas de ne jamais tomber mais de savoir se relever. Merci pour votre aide
Bonjour, Est-il possible d’avoir la réponse concernant les sujets : – Des Fables de La Fontaine – Des Fleurs du Mal de Baudelaire ( Au moins le plan s’il vous plaît ) Merci
Bonjour Amélie, Désolé de te déranger, mais j’aurais aimé savoir si mon plan pour la dissertation sur Les Fleurs du Mal était cohérent. Je me permets donc de l’écrire ci-dessous: I- La laideur peut être une source d’inspiration poétique II- Cependant, la beauté peut suffire comme source d’inspiration III- La poésie ne peut-elle pas s’inspirer d’autre chose que le jugement subjectif? Merci pour tout ce que tu fais! Adam
Bonsoir, j’ai un bac blanc mardi (de français évidemment ^^) et je n’ai étudié pour le moment que la comédie du valet. Dans votre sujet de dissertation que vous proposez, qui est « Pourquoi l’archétype du valet de comédie est-il d’une grande richesse dramaturgique ? », et dans les idées de thèmes pour les parties, vous ne prenez pas en compte un des termes principaux : l’archétype. Donc, je me demandais si en ayant ce thème, nous pouvions traiter tous les valets, mêmes ceux qui sortent de ce carcan, comme Figaro ? Merci par avance pour votre réponse, Ambre.
bonjour à la lecture de la dissertation j’ai fait ce plan qu’en pensez vous ? 1) le personnage de roman: un héro A) des valeurs (Ulysse dans l’odyssée) b) un personnage qui réalise de grande chose (bel ami de Maupassant) c) un personnage fantastique (Harry potter) 2) le personnage de roman un être nuancé A)un personnage réaliste (etienne lantier, germinal de zola) b) un personnage emprunt au doute (Winston smith, 1984) c) l’anti héro (lolita Nabokov) 3)le role du personnage de roman a) Raconter une histoire (la chambre des officiers) b) un représentant d’un monde (colin l’écume des jours) c) faire passer une morale (des souris et des hommes de steinbeck) ouverture le but du romancier
J’ai été choisie cette année par mes professeurs pour participer au concours général des lycéens, j’ai pris l’épreuve de français et je vais devoir passer 6H sur une dissertation, et je n’ai jamais fais de dissertation de ma vie. Mon professeur nous a proposé une dissertation en français sur l’argumentation mais je bloque et je stagne, serait-ce possible d’avoir aide s’il vous plait ?
Est-il possible que la dissertation soit plus facile pour le bac de français que le commentaire?
Les deux exercices font appel à des qualités différentes. C’est à toi de voir lequel de ces deux exercices te semble le plus simple à réaliser.
Bon article mais j’aurais voulu connaître la stucure dans le détail d’une dissertation.
combien de paragraphes peuvent comprendre l’introduction et la conclusion
salut l’introduction on l’a fait en un paragraphe ou en plusieurs paragraphe
bonjour j’ai une dissertation à écrire sur le sujet « dans qu’elle mesure un roman vous permet d’en apprendre davantage sur vous même et sur les autres ? » pourriez vous m’aidez svp
Il ne m’est pas possible de faire de l’aide aux devoirs dans les commentaires. Il faut t’orienter vers un forum ou un tuteur.
Bonjour cela m’aide beaucoup mais comme toujours j’ai des problèmes pour commencer une introduction surtout sur la thématique de mon sujet « L’amour évoqué dans les oeuvres théâtrale lues n’est-il que badinage? » je tiens à dire que je suis en seconde et que mon cerveau est actuellement le désert de Gobi.
Bonjour Amelie, j’ai une question au sujet de la dissertation. Au moment de formuler ma problématique sois je n’en trouve pas, sois je vais trop loin et frôle le hors sujet. Je n’arrive pas à reformuler le sujet. Pouvez-vous m’aider ?
Bonjour Nayanka, La problématique n’ est pas une simple reformulation du sujet. Tu dois mettre en valeur les différentes questions suscitées par le sujet afin de montrer son intérêt. Je te conseille de t’inscrire à ma formation gratuite en 10 leçons pour voir mes vidéos sur la dissertation. Bon courage.
Merci pour cet article. Il aurait été intéressant de parler des personnages avec les influences des 3 déterminismes (sociaux, historiques et biologiques) qui justement apportent un côté scientifique, fatal quant à la vie des personnages et montrent que le personnage n’a pas réellement de côté extraordinaire –> Toute l’oeuvre de Zola.
Une dissertation n’a pas vocation à être un cours exhaustif sur un sujet donné et il y a bien sûr d’autres développements possibles et d’autres exemples de personnages qui pourraient être mis en avant.
Bonsoir Amélie, je me suis permise de vous envoyer un message privé par mail pour que lire ma dissertation, je ne voulais pas qu’elle fasse objet de plagiat,
Bonjour Claire, Je n’ai malheureusement pas le temps de corriger vos devoirs par email. J’ai déjà beaucoup d’élèves à corriger, je ne peux réaliser ce travail pour davantage de personnes !
Bonjour Amélie, je trouve votre site très intéressant et très bien expliqué. J ai une dissertation sur la phrase suivante « cette histoire est vraie puisque je l ai inventée » de Boris Vian. Si on analyse la phrase de loin, on peut reconnaître un paradoxe mais on s aperçoit que la vérité ce n est pas la réalité. En effet la vérité relevé de l universalité, elle relève du discours tandis que la réalité et ce qui nous entoure. Mais même après cette analyse, je ne sais pas comment m’y prendre pour faire un plan. Si vous pouviez me aider pour ce sujet, s il vous plaît.
bonjour, Je suis en 1ère S et je n’ai jamais fait de dissertation de ma vie. Mon professeur m’en a donné une à faire, et je n’y arrive pas du tout. Je ne sais même pas quoi mettre dans l’introduction… La question c’est : dans quelle mesure la forme littéraire peut-elle rendre une argumentation plus efficace ? C’est seulement grâce à vous que j’ai compris qu’il fallait faire un plan thématique, merci ! Je voulais un peu m’aider d’internet, parce qu’à part ça, je ne sais rien, et j’ai remarqué que c’était exactement le même sujet que celui de 2007, avec les mêmes textes. Il y a deux ou trois corrigés mais je ne veux pas recopier parce que je ne comprend même pas le raisonnement… S’il vous plait, pouvez-vous m’aider en me disant à peu près quoi mettre dans l’introduction, et comment faire mon plan ? Merci beaucoup d’avance.
Bonjour Shana, Tout d’abord, tu as raison de ne pas recopier quelque chose trouvé sur internet : c’est du plagiat – les professeurs ne sont pas dupes – et puis surtout, cela ne te ferait pas progresser. Tu peux lire quelques ressources mais il est important ensuite de mener un raisonnement par toi-même. Je ne peux pas faire de l’aide aux devoirs dans les commentaires des articles. Juste quelques indications : cherche les raisons qui font que la forme littéraire d’un texte peut rendre le message du texte plus percutant. Appuie-toi sur des exemples concrets pour trouver des arguments (pense par exemple aux contes philosophiques de Voltaire, aux fables de La Fontaine…). Idéalement, tu pourrais trouver deux raisons qui te donneront deux axes. Dans un troisième temps, tu pourrais te demander si c’est réellement la forme du texte qui rend une argumentation plus efficace (d’autres aspects du texte ne sont-ils pas plus importants ? Qu’est-ce qui rend une argumentation efficace ?) Bon courage !
Bonjour, je tenais à vous dire que votre blog est exceptionnel je comprends plus de choses ! Cependant je n’arrive pas à rédiger une introduction de dissertation. Pourriez-vous m’éclairer? Merci d’avance!
Bonjour , j’ai un problème avec une dissertation que je doit au plus vite le sujet : D’après le marquis de Sade, » on appelle roman l’ouvrage fabuleux composé d’après les plus singulières aventures de la vie des hommes. » cette définition vous paraît-elle fondée ? Pour cela il faut s’appuyer sur les textes du corpus ( extraits de L princesse de Clèves de Madame de Lafayette et Bel-Amide Maupassant) .
Bonjour , j’ai un problème avec une dissertation que j’ai à rendre au plus vite, le sujet est « il faut se méfier de ceux qui cherchent à nous convaincre par d’autres voies que celles de la raison » j’ai donc fais deux axes -> persuasion conviction mais j’ai du mal à trouver des sous parties Pourriez vous m’aidez ? Merci d’avance
Bonjour Amélie, Tout d’abord merci pour ton site très complet et très rassurant. Mon professeur de français nous recommande de ne pas préciser dans ma dissertation si le texte que j’utilise comme exemple provient du corpus. Cependant je vois de nombreuses corrections de dissertation où il est écrit « Texte B du corpus »… Est-il obligatoire de préciser qu’il est extrait du corps? Merci d’avance
bonjour j’ai une dissertation a rendre pour la rentrée j’ai la problématique « est-il plus efficace de défendre une cause ou de dénoncer une injustice a travers une fiction ou une argumentation » mais je ne comprend pas comment je pourrais la rédiger, j’ai également regarder vos explications. Je ne c’est pas mettre en oeuvre pouvez vous me donner des indices merci.
BONSOIR. Merci beaucoup, vos cours sont vraiment bénéfiques et très utiles. je vous souhaite bonne continuité.
Bonjour ! Tout d’abord, merci beaucoup pour vos cours qui me sont vraiment très utiles ! Je voulais vous demander jusqu’où nos exemples peuvent aller dans une dissertation. Je m’explique : dans une dissertation sur la poésie, peut-on citer des artistes contemporains comme le groupe Fauve Corp ou Saez ? Et dans le roman, des oeuvres récentes comme Yasmina Khadra, etc… Merci d’avance pour votre réponse !
Bonjour, j’ai une dissertation à faire sur le héros en littérature. Je suis un peu perdu, j’hésite quant au plan. 2 ou 3 parties? I le héros II l’anti héros
Bonjour j’ai une dissertation à faire. Elle est la suivante: Qu’attendez-vous d’un personnage de roman? Qu’il vous fasse rêver ou qu’il vous renvoie aux dures réalités de l’existence? Je pense construire un plan dialectique dans une première partie le personnage de rêve, dans une seconde le personnage réaliste et dans une troisième et dernière partie une confrontation de mes deux premières idées en parlant d’un personnage de roman qui fait rêver tout en étant réaliste. Pensez-vous que ma dernière partie est pertinente? si oui pouvez-vous me donner des œuvres qui pourraient constituer des exemples concrets pour ma partie. Merci d’avance.
Bonjours j’aimerais avoir quelques argument sur la question de la dissertation suivante : un poeme fait t’il toujours entendre plusieurs voix ? ( je trouve ca assez compliquer…) ( je suis en 1S). 🙂 merci d’avance
Amelie je ne comprends pas pourquoi vous considérez que les personnages du texte A « Colette » sont extraordinaires? Au contraire, ils sont tout à fait réalistes, je pense … non?
mdm Amélie s’il vous plais j’ai un examin sur le dictionnaire philosophique de voltaire et j rien compris comment je travail un dissertation pouvez vous m’aidé et me donner quelques exemples
s il vous plait ameli demain j ai un devoir mais c prevu d avoir une dissertation concernat la peste d albert camus pouvez vous m aider et me donner quelque exemple de dissertation analysée à propos la peste /merci bcp
Je ne peux pas te faire plusieurs dissertations sur La Peste en une soirée 😉 Pour réviser, revois les enjeux de cette oeuvre, son thème, le symbolisme de le peste dans le roman et visionne également ma vidéo sur l’absurde chez Camus .
Merci beaucoup pour cet exemple de dissertation ! J’aimerais savoir si il était possible d’avoir une méthode et/ou un exemple de rédaction d’introductions de dissertations.
Merci pour tous vos articles encore une fois !
Bonjour, je suis en 1ere ES et je commence a découvrir la dissertation sauf que je n’arrive pas a trouver un plan convenable… Malgré de longue recherche, il y a beaucoup de possibilité. Le sujet donné est le suivant: « Dans cette oeuvre les indiens du nouveau monde, des hommes comme les autres ? » l’oeuvre en question est la pièce de théâtre « La controverse de Valladolid » de Jean-Claude Carrière. je sais déjà que c’est un plan dialectique que je dois utiliser. il faut je pense parler des colonisations des années 1500. Mais impossible de trouver un plan … pourriez-vous m’aider s’il-vous-plais ?
Je ne peux pas faire d’aide sur mesure pour vos devoirs. Un plan dialectique est tout à fait envisageable pour ce sujet, mais c’est en réfléchissant sur l’oeuvre de J.C. Carrière et sur les différentes façons dont les indiens y sont caractérisés que tu parviendras à répondre à cette question.
Merci beaucoup 🙂
j’ai une dissertation à faire c’est urgent et j’ai besoin d’aide voici le sujet : Dissertation sur l’argumentation Vous direz quels types de textes argumentatifs (apologues ou argumentation directe) vous préférez, en expliquant pour quelles raisons. Vous développerez trois arguments et trois exemples dans chaque partie. vous prendrez vos exemples dans les textes et oeuvres lus et étudiés en cours
Bonjour Amélie !
J’ai découvert votre blog il y a quelques mois de cela et il est vraiment TOP ! Demain, je pars dans l’optique de choisir la dissertation car durant l’année, j’ai eu les meilleurs notes dans ce sujet mais c’est aussi parce que j’apprécie la dissertation. Par contre, notre prof nous a dit que nous étions obligés de reformuler une problématique à partir du sujet. J’ai donc un doute maintenant. Selon le correcteur, y a-t-il une chance de perdre des points parce que nous avons repris la question posée par le sujet ?
Merci d’avance !! 🙂
Bonjour amelie, j ai un sujet de dissertation que je ne comprend pas pourriez vous me l expliquer ? Le sujet est : quelle place, la representation theatrale laisse elle a l imaginaire du spectateur ? Merci d avance
Merci ! Je cherchais un exemple de dissertation afin de m’améliorer !
bonjours, je me pose une question, comment peut t’on présenté clairement nos différente partie alors que ces dernière doivent être rédigé ? en somme, comment faire une syntaxe de notre plan ?
Est ce que dans A du grand II, personnage psychologique, nous pouvons donner comme exemple La princesse de Clèves de Madame de Lafayette et aussi Jeanne dans Une vie de Maupassant ?
Ps: la Dissertation permet-elle réellement d’avoir une bonne voir très bonne note par rapport au commentaire ? Dans quel mesure prendre le commentaire ? Merci encore
Bonjour, Amélie voila je suis en 1 ère et le bac arrive a grand pas et j’hésite a choisir le commentaire ou la dissertation. Car j’ai eu 8.5/16 en dissertation au 2ème bac blanc alors que j’avais eu 15/20 au 1er. Mais pour le commentaire j’ai beaucoup de difficulté j’ai fait 4 commentaire dans l’année et pour tout les 3 j’ai eu en dessous de la moyenne et 1 seule ou j’ai eu 12/20 sachant que c’était un dm. Mais le problème c’est que j’ai peur de ne pas avoir assez de connaissance sur le sujet proposé. J’aimerais aussi savoir, si vous aviez une idée concernant les genres / thèmes susceptibles de tombées et les question qui permettrait d’orienter mes révisions car je ne sait pas trop comment et quoi réviser( ex: théâtre: Les Metteurs en scène sont il des artistes a part entière ? ) Merci
Est ce qu’il aurait été possibles en ce qui concerne les personnages réalistes de parler des romans naturalistes et réalistes ?
bonsoir j’ai trouvé un bon sujet de dissertation mais pas la réponse si vous pourriez m’aider alors c’est est ce qu il faut comprendre la poésie ?
bonsoir, je vous écris pour vous remercier car je ne sais pas si il y a un lien mais depuis que je suis la formation gratuite mes 8 en contrôle et 8.5,9 en bac blanc se sont transformés en 13 en dissertation en classe et 13 au dernier bac blanc et ces vidéos m’ont donc été bénéfiques.
Bonjour Amelie j’ai bientôt un bac blanc . Et ma prof de français nous conseille de choisir la dissertation . Mais la question de dissertation me paraît souvent difficile . Dans quel cas puis je la prendre ou pas ? Merci d’avance .
Bonsoir Hayete, La dissertation est un bon choix quand on sait dérouler un raisonnement pour répondre à une question (il faut être très logique et maîtriser l’art de la nuance) et lorsqu’on a de solides connaissances littéraires. En effet, une dissertation où vous ne citez que le textes du corpus (faute d’en connaître d’autre) est pauvre et peu convaincante. Aussi, choisis la dissertation si tu es à l’aise avec cet exercice et si tu es capable de justifier tes idées avec des exemples variés et précis. Autrement, il est plus intéressant de se tourner vers le commentaire littéraire.
Bonjour, Il y a 3 jours, nous avons eu un bac blanc où j’ai pris la dissertation et je me rappel du mois de novembre avec le première où j’avais pris la dissertation également, sauf que je me souviens que d’après le correcteur je détournais le sujet: la question était « faut t-il qu’un personnage prenne la parole pour exister? » et l’objet d’étude le théâtre, et j’ai dis comme problématique reformulée que « nous allons nous demander si les acteurs doivent obligatoirement utiliser le texte pour faire passer un message » car pour moi, le fait d’exister signifiait, jouer son rôle qui est à travers une histoire et un contexte de faire passer un message. Merci d’avance
Bonsoir Marc-Antoine, Effectivement, ta problématique dénaturait le sujet. Dans une dissertation, la problématique est une reformulation du sujet qui met en valeur le paradoxe ou les enjeux de ce dernier; mais elle ne doit pas transformer le sujet . Si tu as trop de doutes sur ta problématique, le mieux est de garder le sujet tel quel (à votre niveau, c’est acceptable).
Laisse un commentaire ! X
Merci de laisser un commentaire ! Pour des raisons pédagogiques et pour m'aider à mieux comprendre ton message, il est important de soigner la rédaction de ton commentaire. Vérifie notamment l'orthographe, la syntaxe, les accents, la ponctuation, les majuscules ! Les commentaires qui ne sont pas soignés ne sont pas publiés.
Site internet
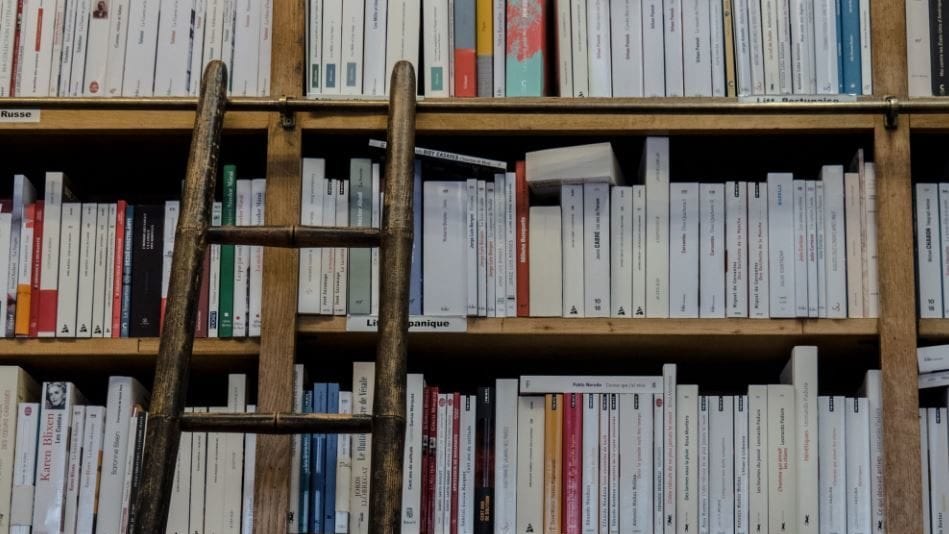
Commentaire et dissertation
Le naturalisme.

Le Naturalisme est un mouvement littéraire et culturel du XIXème siècle dont le chef de file est Emile Zola . Le Naturalisme s’inscrit dans la lignée du Réalisme qui le précède auquel il ajoute une dimension scientifique.
Tout d’abord, il faut rappeler que les différentes esthétiques ne sont pas séparées mais peuvent au contraire cohabiter en une même époque. Nous délimiterons cependant trois périodes principales pour le XIXe siècle:
- En premier lieu, le Romantisme qui occupe toute la première moitié du siècle.
- En deuxième lieu, de 1848 à 1868 : le Réalisme .
- Cette tendance annonce le Naturalisme , mouvement qui se développe à la fin du siècle (jusqu’en 1887 à peu près).
Les origines sociohistoriques du Naturalisme
Le réalisme et le naturalisme reflètent les préoccupations de leur temps, ils sont donc particulièrement symboliques de l’agitation historique et politique.
A/ De nouvelles couches sociales
- La révolution avortée de 1848 crée la désillusion (le rêve d’une république fidèle aux idéaux de 1789 s’effondre).
- La bourgeoisie devient la classe sociale dominante à la place de l’aristocratie qui dominait avant la révolution française. Elle repose à la fois sur l’individualisme et sur l’argent.
- La révolution industrielle après s’être développée en Angleterre s’impose. Les paysans quittent les campagnes et forment le prolétariat c’est-à-dire les travailleurs des villes.
- La Révolution crée une nouvelle opposition entre les classes : les rapports entre le prolétariat et la bourgeoisie remplace les rapports entre l’aristocratie et la bourgeoisie (d’avant 1789) .
- Les conditions de vie des classes défavorisées se dégradent tandis que la bourgeoisie s’enrichit.
B/La révolution scientifique et industrielle:
- La foi illimitée dans le progrès se répand dans toutes les couches de la société.
- Les découvertes scientifiques sont immenses. (voir par exemple l’enthousiasme d’Emile Zola dans la préface de Thérèse Raquin pour les théories biologiques d’un Claude Bernard notamment) .
- La science est perçue comme la solution à tous les problèmes. La science remplit tous les espoirs et supplante Dieu.
- Le matérialisme s’accentue. (avec l’émergence de la bourgeoisie)C’est un mouvement qui se développe tout au long du XIXème, en témoignent les romans de Balzac déjà avec des personnages de banquiers.
C/ La philosophie positiviste d’Auguste Comte (années 1820) :
La philosophe elle-même cherche à s’appuyer sur les faits réels, » positifs « . Elle part en quête de certitudes précises, pour éviter les approximations.
Ainsi, le Naturalisme trouve ses origines dans le contexte socio-politique mais il se crée aussi en réaction à d’autres mouvements littéraires.
2 Ses origines littéraires :
A/ Dans la lignée du Réalisme
Le mouvement réaliste se développe à partir de 1848, au moment de la Révolution. Les thèmes abordés concernent principalement l’influence du milieu sur les individus, la vie urbaine ou provinciale et les misères et ascensions sociales.
B/ En opposition avec le Romantisme
Quant au romantisme, il était centré sur le regret d’un passé idéalisé ou sur le désir de créer un futur merveilleux alors que le Réalisme s’ancre dans le présent et dans le quotidien.
La littérature se fait le miroir des bouleversements sociaux.
La bourgeoisie et le monde ouvrier deviennent des terreaux pour de nouveaux types de personnages. Leurs héros sont médiocres, ordinaires alors que le héros romantique incarnait un idéal.
En outre, le Réalisme et le Naturalisme voient l’âge d’or du roman qui jusque-là était un genre peu valorisé. (face à la poésie et à la tragédie notamment)
3) Le Naturalisme :
a/ l’origine du terme « naturalisme ».
Le mot apparaît vers 1870.
Cependant, pendant longtemps le Réalisme et le Naturalisme restent indifférenciés.
Le Naturalisme s’inscrit dans la lignée de la biologie qui connaît un véritable essor. C’ est une théorie qui considère que l’art doit être une reproduction de la nature,
Le terme est repris par Zola et modifié sous l’influence de Claude Bernard.
B/La théorisation du naturalisme
C’est Zola qui définit véritablement les contours de ce mouvement.
Il explique dans Le Roman expérimental sa théorie du roman fondée sur :
» ce rêve du physiologiste et du médecin expérimentateur, [rêve qui] est aussi celui du romancier qui applique à l’étude naturelle et sociale de l’homme la méthode expérimentale. […] Nous sommes en un mot des moralistes expérimentateurs, montrant par l’expérience de quelle façon se comporte une passion dans un milieu social. Le jour où nous tiendrons le mécanisme de cette passion, on pourra la traiter et la réduire, ou tout au moins la rendre la plus inoffensive possible « .
La pensée d’Emile Zola s’inscrit également dans les théories socialistes qui se développent alors. Il veut exposer avec précision les maux de la société pour mieux en expliquer les causes et les symptômes.
c) Quelles ont été les influences de la médecine et des sciences expérimentales sur le naturalisme ?
- Le naturalisme comporte une volonté scientifique que n’avait pas le Réalisme . Le romancier accomplit des expériences avec ses personnages et en tire toutes les conclusions. (voir Zola avec ses personnages dans la préface de Thérèse Raquin ) L’auteur vérifie le rôle des déterminismes sociaux et de la génétique. (voir les conséquences de l’alcoolisme sur sa descendance dans la descendance des Rougon-Macquart par exemple) Il s’agit aussi comme en biologie d’observer le rôle du milieu dans lequel évolue le personnage.
- En outre, le romancier s’efforce de montrer l’objectivité du scientifique pour traiter ses personnages.
- De plus, comme le faisait l’auteur du Réalisme , le romancier du Naturalisme se documente sur les sujets traités dans ses oeuvres. (Ex: Emile Zola concernant les mines dans Germinal )
- Enfin, les ouvriers sont très nombreux dans les romans naturalistes et témoignent de la place occupée par la Révolution industrielle.
d) Les soirées de Médan:
Autour de Zola gravitent de nombreux romanciers:
- les frères Goncourt
En 1880 seront publiés Les soirées de Médan (Un recueil de nouvelles est publié au terme de ces rencontres littéraires dans lequel paraît Boule de suif).
En 1884 est publié A Rebours de Huysmans. Mais la discorde s’installe au sein du groupe naturaliste.
En 1887, est publié le « manifeste des Cinq contre La Terre » qualifiée de « roman scatologique ».
Pour conclure, il convient de rappeler que le Naturalisme se développe également dans d’autres domaines que le roman:
- le théâtre (A l’origine Thérèse Raquin était une pièce de théâtre)
- la peinture dans les oeuvres de Manet et des impressionnistes s’apparente à la démarche naturaliste dans la littérature. L’incipit de l’ Oeuvre de Zola, par exemple, montre l’influence de la peinture impressionniste sur l’écriture romanesque.
Le Symbolisme de Moréas, Mallarmé, Rimbaud ou Verlaine suivra le Naturalisme et, comme le Naturalisme s’opposait au Romantisme, Le Symbolisme s’opposera au Naturalisme. (Souvent les mouvements culturels se succèdent et les plus jeunes se rebellent face à leurs aînés selon le schéma de la querelle des Anciens et des Modernes).
Nous espérons que cette fiche sur le mouvement naturalisme a été utile. Tu seras peut-être intéressé également par les cours ci-dessous.
– Thérèse Raquin incipit (chapitre 1)
– Thérèse Raquin (chapitre 13)
Thérèse Raquin (chapitre 21)
– Thérèse Raquin (chapitre 32)
– L’oeuvre de Zola (chapitre 1)
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *
Commentaire *
Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées .
Pour s'améliorer en français
Oral du bac de français
Ecrit du bac de français, pour aller plus loin.
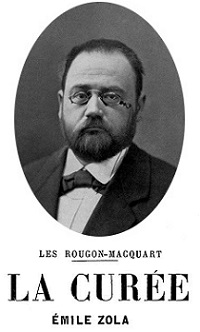
Exercices de lecture
Zola, le réalisme et l’imagination
- François-Marie Mourad
Diffusion numérique : 30 novembre 2015
Un article de la revue Études françaises
Volume 51, numéro 3, 2015 , p. 167–187 La corde bouffonne. De Banville à Apollinaire
Tous droits réservés © Les Presses de l’Université de Montréal, 2015
Zola, on le sait, réprouve une imagination livrée à elle-même. Une remarque polémique parue dans la presse en 1866 sert de point de départ à une réflexion sur le statut de cette faculté dans la tradition réaliste. Le discrédit zolien radicalise l’opposition entre les usages déréglés de la fiction et les enjeux épistémologiques d’une littérature concernée par le réel. La question est alors d’actualité si l’on en juge par les contrepoints apportés par Balzac, Hugo, Baudelaire, Flaubert, moins réticents sur le principe d’une contribution active de l’imagination au sein même du projet réaliste. Zola précisera sa poétique dans Le roman expérimental (1879). On retient l’idée d’une « déchéance de l’imagination » mais deux nuances essentielles tempèrent ce postulat naturaliste : traquée au sein de l’ inventio , l’imagination est recyclée dans la dispositio et l’ elocutio ; elle est ensuite hypostasiée dans ce que Zola appelle « le sens du réel », avatar du réalisme tempéramentiel, d’origine romantique, défendu dans Mes haines . En définitive, la position de Zola, quand on la contextualise, qu’on la compare et qu’on la relativise, n’est pas si éloignée d’autres revendications en faveur du réalisme artistique.
As one knows, Zola disapproved of imagination left unto itself. The starting point of our reflection on the status of imagination in the realist tradition is a polemical remark that Zola wrote in a newspaper in 1866. The disfavour of the imagination that Zola expresses toughens the opposition between the unchecked use of fiction and the epistemological issues raised by a literature concerned with the real. This question was quite topical at the time, as one can see from the counter-arguments made by Balzac, Hugo, Baudelaire, and Flaubert, who were less reluctant to recognize the active role of imagination within the realist project. Zola is more specific about his poetics in Le roman expérimental (1879). Accordingly, one must pay attention to the idea of the “decline of the imagination” ( déchéance de l’imagination ), but also to two important nuances, whose role is to moderate this realist postulate: tracked down within the notion of invention , imagination is recycled in disposition and elocution and eventually reified through what Zola terms “the sense of the real” ( le sens du réel ), an aftermath of the “réalisme tempéramentiel,” of Romantic origin, that he supported in Mes haines . All in all, Zola’s position, properly contextualized, compared and put into perspective, is not as remote as one would think from other claims to artistic realism.
Corps de l’article
La littérature continue d’être fréquemment définie comme un art d’agrément faisant un large usage de l’imagination, de la faculté de former des images, de les assembler sous le régime général de la fiction, cet art de feindre qui n’exclut pas la fantaisie. Cette conception familière et évasive ne peut être dissociée du jugement de valeur qui entre pour une part dans le classement des activités humaines, en particulier dans le rapport qu’elles entretiennent avec le réel. Les philosophes et les artistes se sont saisis très tôt des concepts d’ imagination et de réalisme et leur ont donné une multitude de significations relatives et polémiques. Autant dire qu’on ne doive avancer qu’avec prudence dans cette problématique générale où s’intriquent les définitions essentialistes et les mots d’ordre des écoles. Même s’il n’est, en 1866, à vingt-six ans, qu’un journaliste littéraire inconnu du grand public, Zola, au détour de l’une de ses chroniques de L’Événement [1] , exhibe une conception de la littérature que l’on a coutume de rattacher à son naturalisme : « Je suis très difficile pour les oeuvres de pure imagination, n’ayant pu encore comprendre la nécessité du rêve, lorsque la réalité offre un intérêt si humain et si poignant [2] . » Ce serait aller vite en besogne que de rattacher trop étroitement cette première déclaration au credo théorique du Roman expérimental (1880). Il n’en reste pas moins qu’à la veille de rédiger Thérèse Raquin (qui paraîtra en 1867), Zola a amorcé son virage vers le réalisme , conçu, depuis l’univers parent de la peinture, comme la rupture d’un double front : d’abord celui de la tradition artistique classique privilégiant les procédures de transposition esthétique , la quête persistante du Beau et un répertoire de sujets académiques ; ensuite celui d’une modernité romantique prônant le rêve et se livrant aux séductions et aux fastes d’un imaginaire à promouvoir, pour dépasser les apories et les limites du premier positivisme des Lumières, qui prenait lui-même appui sur le rationalisme cartésien. En vérité, dans le contexte de critique littéraire journalistique courante à laquelle Zola est astreint, qui l’oblige à compiler le tout-venant d’une production éditoriale en plein essor, « les oeuvres de pure imagination » renvoient surtout à la littérature feuilletonnesque, aux « contes bleus », aux histoires seulement inventées , qui trahissent le manque de conscience artistique et empruntent la voie de la facilité : c’est le laisser-aller en la matière qui pose problème, l’usage factice d’un pouvoir de l’esprit (que les anciens nommaient la phantasia [3] , créatrice d’images « libres ») envers lequel Zola manifeste une réticence condescendante. En revanche, son propos engage une vibrante apologie de la « réalité », doublement valorisée parce qu’elle s’offre à l’artiste comme un riche répertoire de sujets « vrais », à la fois directs et dramatiques. Est ainsi engagée, par la rhétorique de l’étonnement, la réfutation des arguments habituels des adversaires du réalisme, qui fondent leur désintérêt, pour des raisons esthétiques et morales, sur l’idée de médiocrité du réel. Nous devrons d’abord soutenir la démarche de réhabilitation du réalisme par Zola, en comprenant pourquoi, dans l’espace ménagé par sa critique des usages courants de l’imagination littéraire, il y aurait place pour un réalisme artistique non pas monotone et réducteur, mais au contraire intense et consistant . Comme l’imagination n’est pas rejetée par Zola dans son avis critique, nous nous interrogerons sur son statut dans la création littéraire, sans viser l’exhaustivité mais en postulant son omniprésence et la variation plus ou moins maîtrisée de ses usages, avant d’en venir, sans perdre de vue la question du rapport entre le réel et l’imaginaire, au constat non seulement d’une impossible séparation entre les deux mais plutôt d’une évidente réhabilitation de l’imaginaire, constitutif de l’ordre de la représentation artistique, à concevoir comme une révélation, de ce qui est comme de ce qui n’est pas encore.
Par l’expression d’« oeuvres de pure imagination », Zola radicalise l’opposition entre le rêve et la réalité dans une intention polémique, en agglomérant plusieurs perspectives, de la genèse de l’oeuvre à sa réception : le jugement concerne autant la forme choisie que les thèmes et, implicitement, la conception des personnages, des situations… tous les constituants habituels de l’oeuvre littéraire au sens large. Parlant ici en journaliste impliqué dans l’instruction du public, il est probable que Zola, averti des enjeux de la culture de masse émergente, adopte principalement le point de vue du lecteur . La situation éditoriale générale en 1866 n’est pas foncièrement différente de celle que l’on connaît aujourd’hui, elle en est même la préfiguration historique. Pour la première fois, les progrès de l’instruction, le développement des techniques (de fabrication, de transmission et de communication) et les évolutions politico-économiques créent effectivement, sous le Second Empire, les conditions d’une littérature industrielle [4] . Plus encore qu’à l’époque où Sainte-Beuve en distinguait les redoutables prémices, cette « littérature » appelée par les besoins de la presse se développe quand la génération issue de la réforme Guizot [5] a atteint l’âge adulte. Nous tenons ici une interprétation contextuelle de l’expression zolienne, dans le sillage polémique des dénonciations unanimes de la littérature « facile », bâclée, sans conscience, superficielle et factice :
Les journaux s’élargissant, les feuilletons essaiment, l’élasticité des phrases a dû prêter indéfiniment, et l’on a redoublé de vains mots, de descriptions oiseuses, d’épithètes redondantes : le style s’est étiré dans tous ses fils comme les étoffes trop tendues [6] .
C’est évidemment le feuilleton-roman des années 1830 que dénonce ici le critique de la Revue des Deux Mondes et, après La comtesse de Salisbury d’Alexandre Dumas ou La vieille fille de Balzac, il déplore l’inclusion et l’abaissement de la littérature dans le régime de la diction médiatique qui, pour justifier d’un coût, même faible, appâte le public par la gratuité de la fiction. Se trouve alors sélectionné et surexploité un constituant séculaire de cette fiction, déjà dénoncé par Platon comme un charme dangereux, à savoir la faculté d’absence, de divertissement . Vite passionnelle, c’est-à-dire passive, elle efface les distinctions et dilue les repères. Force est de constater qu’à toutes les époques, dans une sorte de jeu bien réglé de l’offre et de la demande, des « oeuvres de pure imagination », produites par des professionnels avisés – tâcherons et/ou experts –, ont satisfait un public affamé d’« histoires » et de rêves. Des almanachs à la littérature de colportage, des histoires de géants qu’exploitera Rabelais à la littérature de l’éloignement [7] décrite par Thomas Pavel, l’histoire du roman, en particulier, est profondément marquée par cette empreinte anthropologique de la fiction, par ce charme et cet enchantement dont est comptable tout récit. De grands écrivains, lucides sur ce point, ont thématisé les périls du romanesque au sein de leurs oeuvres. Cervantès ouvre ainsi Don Quichotte par l’évocation de la folie de son personnage, définitivement absenté d’un réel prosaïque , indigent et médiocre, auquel son esprit dérangé substituera désormais, à chaque occasion d’un périple suicidaire et schizophrène, les mirages chatoyants issus de l’univers des romans de chevalerie :
Il dormait si peu et lisait tellement que son cerveau se dessécha et qu’il finit par perdre la raison. Il avait la tête pleine de tout ce qu’il trouvait dans ses livres ; enchantements, querelles, batailles, défis, blessures, galanteries, amours, tourments, aventures impossibles. Et il crut si fort à ce tissu d’extravagances que, pour lui, il n’y avait pas d’histoire plus véridique au monde [8] .
En plein xix e siècle, Flaubert, fasciné par ce livre fondateur [9] , en reprend quelque peu la donnée, avec Madame Bovary – cette Doña Quichotte en jupons – en en accentuant le caractère critique et déceptif. Si Emma, jeune mariée, reste littéralement insensible aux témoignages d’amour de son époux, qui « lui donnait sur les joues de gros baisers à pleine bouche [10] », c’est parce que la seule signalétique qui fasse foi en la matière est celle, imaginaire, des livres qui ornent sa bibliothèque : « Et Emma cherchait à savoir ce que l’on entendait au juste dans la vie par les mots de félicité , de passion et d’ ivresse , qui lui avaient paru si beaux dans les livres. [11] » Avec beaucoup d’habileté, Flaubert opère un premier décrochage de sa propre fiction après cette phrase-programme qui clôt le chapitre v et il entreprend, au début du chapitre vi , une patiente anamnèse de son personnage :
Elle avait lu Paul et Virginie et elle avait rêvé la maisonnette de bambous, le nègre Domingo, le chien Fidèle, mais surtout l’amitié douce de quelque bon petit frère, qui va chercher pour vous des fruits rouges dans des grands arbres plus hauts que des clochers, ou qui court pieds nus sur le sable, vous apportant un nid d’oiseau [12] .
On comprend tout de suite, par le détail, le sens de cette évocation, grâce à la technique de la focalisation interne : le lecteur est invité à connaître le fonctionnement mental du personnage et, en tant que lecteur supposé connivent par l’auteur souverain, à en juger. La critique est alors possible : ces images sont des clichés, seule la sensibilité est affectée, le rêve d’harmonie déporte le personnage loin du réel et la notion de bovarysme sera même forgée par Jules de Gaultier (en 1892) pour caractériser une dangereuse tendance à l’affabulation, une névrose d’ailleurs spécifiquement féminine dont Balzac avait déjà établi les linéaments dans La femme de trente ans (1834). Dans sa préface, à propos de son personnage « mental » (non pas une « figure », mais une « pensée »), l’auteur déclare que son « ambition est de communiquer à l’âme le vague d’une rêverie où les femmes puissent réveiller quelques-unes des vives impressions qu’elles ont conservées, de ranimer les souvenirs épars dans la vie, pour en faire surgir quelques enseignements [13] ». Se dévoile ici une attitude moderne de réhabilitation de l’imaginaire féminin qui va à l’encontre du préjugé d’infantilisation associé à cette capacité mentale. Zola partage généralement ce préjugé : il considère que le roman, genre prisé par les femmes, s’avilit dans la narrativité pure et gratuite, la romance . Comme Platon, il estime que la fiction doit être sévèrement encadrée et non laissée à elle-même.
Nous sommes de grands enfants, et, si les romanciers savaient le peu de vérité et d’émotion qu’il faut pour nous émouvoir et nous passionner, ils n’iraient certes pas chercher des histoires impossibles et ridicules, dans lesquelles ils promènent de grotesques poupées bourrées de son. 2 juillet 1866, OC , x , 524
On voit, par cette nouvelle citation zolienne, que le reproche vise une sorte d’« enfance de l’art », baignée de naïveté et accusant un penchant marqué pour l’irréalité que l’on dit trouver prioritairement dans les contes, les romans de la comtesse de Ségur, les livres de Jules Verne ou les histoires d’Erckmann-Chatrian, pour rester encore un peu dans un contexte historique marqué par les efforts de distinction épistémologique des usages de la fiction, surtout à partir du geste balzacien de l’avant-propos à La comédie humaine (juillet 1842). Un retour attentif vers ce texte clé s’impose, mais Zola, dans le sillage de Taine, l’a lu comme l’acte de naissance du roman moderne, conçu comme un genre parascientifique fondamentalement sérieux :
Si j’avais demandé à Balzac de me définir le roman, il m’aurait certainement répondu : « Le roman est un traité d’anatomie morale, une compilation de faits humains, une philosophie expérimentale des passions. Il a pour but, à l’aide d’une action vraisemblable, de peindre les hommes et la nature dans leur vérité. » OC , x , 281-282
Dans ce propos prévu pour la trente-troisième session du Congrès scientifique de France d’Aix-en-Provence en décembre 1866, les termes qui appartiennent au lexique scientifique (traité, anatomie, compilation, faits, expérimentale) sont à la fois nuancés et complétés dans la deuxième phrase par ceux qui relèvent du champ artistique « classique » au sens large : ut pictura scientia , en quelque sorte. La rigueur est compatible avec le simulacre de l’ action , dans le processus de la vraisemblance . La perspective documentaire de recollection des faits n’est évidemment pas absente, mais il convient d’observer que cette « compilation » est sans exclusive et qu’elle vise la société humaine, ce que Balzac appelait les « espèces sociales ». Quand le « Nouveau Roman », de Robbe-Grillet par exemple, cherchera à s’imposer au nom du réalisme, il le fera, au rebours de Balzac, en évacuant le sujet humain, à la fois maître souverain et objet privilégié de la création artistique, et en privilégiant les lieux et les objets, saisis dans leur être-là , sans signification particulière, comme l’analyse Roland Barthes, à propos des Gommes , dans « Littérature objective » :
L’écriture de Robbe-Grillet est sans alibi, sans épaisseur et sans profondeur : elle reste à la surface de l’objet et la parcourt également, sans privilégier telle ou telle de ses qualités : c’est donc le contraire même d’une écriture poétique. Ici, le mot n’explose pas, il ne fouille pas, on ne lui donne pas pour fonction de surgir tout armé en face de l’objet pour chercher au coeur de sa substance un nom ambigu qui la résume : le langage n’est pas ici viol d’un abîme, mais élongement à même une surface, il est chargé de « peindre » l’objet, c’est-à-dire de le caresser, de déposer peu à peu le long de son espace toute une chaîne de noms progressifs, dont aucun ne doit l’épuiser [14] .
Ce n’est pas de ce réalisme objectal que relèvent les descriptions balzacienne ou zolienne. Le quartier de tomate « sans défaut, découpé à la machine dans un fruit d’une symétrie parfaite », tel qu’il est « montré » avec minutie et laconisme dans Les gommes [15] , n’a pas grand-chose à voir avec les étals des maraîchers du Ventre de Paris et « l’épanouissement charnu d’un paquet d’artichauts, les verts délicats des salades, le corail rose des carottes, l’ivoire mat des navets [16] ». Plus proche d’un projet du « livre sur rien », dans la lignée flaubertienne, le Nouveau Roman ne médiatise pas le descriptif et, quand il s’y attarde, il dissout, par l’application, la précision et la sophistication, l’illusion réaliste soigneusement ménagée par les démiurges du xix e siècle.
Le réalisme que défend et illustre Zola est dans un entre-deux : il n’emprunte en aucune façon la voie du réductionnisme schématique. Il rend au contraire hommage à une réalité conçue non pas comme un espace-temps inaltérable et une pure extériorité, mais plutôt comme un milieu . L’idée de raconter l’« histoire », fût-elle « naturelle et sociale », « d’une famille sous le Second Empire », renvoie à cette conception d’une réalité sous juridiction humaine, habitée au sens fort, c’est-à-dire portant l’empreinte du social : toujours symbolique, liée au destin des personnages représentatifs, qu’ils soient des types ou des spécimens. Ainsi la serre, dans La curée , est-elle le lieu des désirs exotiques et érotiques de Renée. La complaisance de l’énumération des espèces végétales inventoriées par Zola à partir de la fiche encyclopédique rédigée après sa visite au Jardin des Plantes est, en fin de compte, dépassée, sublimée, par les nécessités démonstratives de la diégèse et les plantes, décrites comme sournoises et capiteuses, sont l’allégorie des désirs secrets du personnage principal :
dans un coin, un Bananier, chargé de ses fruits, allongeait de toutes parts ses longues feuilles horizontales, où deux amants pourraient se coucher à l’aise en se serrant l’un contre l’autre. Aux angles, il y avait des Euphorbes d’Abyssinie, ces cierges épineux, contrefaits, pleins de bosses honteuses, suant le poison [17] …
Le rapprochement avec Renée s’accentue, au fil de pages de plus en plus suggestives, et la description se résout en une explication parfaitement claire, à valeur d’acmé :
Un amour immense, un besoin de volupté, flottait dans cette nef close, où bouillait la sève ardente des tropiques. La jeune femme était prise dans ces noces puissantes de la terre, qui engendraient autour d’elle ces verdures noires, ces tiges colossales [18] .
Zola n’hésite donc pas, pour doter la « réalité » d’un « intérêt » humain et poignant, à faire un large usage de tous les moyens littéraires qu’il a à sa disposition, en procédant à un inventaire sans exclusion des genres et du matériel verbal en circulation dans le champ de la rhétorique générale des sciences – humaines, sociales, expérimentales, esthétiques. Sont alors compris dans ces ressources les procédés de l’écriture artiste , les métaphores (y compris baudelairiennes), les épithètes animistes, l’ ekphrasis , l’hypotypose, les gauchissements évaluatifs… qui font de chaque description – l’aire Saint-Mittre dans La fortune des Rougon , le Paradou dans La faute de l’abbé Mouret , le repas de noce de Gervaise et l’alambic dans L’assommoir , le Voreux dans Germinal , etc. – un lieu privilégié de ce réalisme enchanté, à la fois gorgé de significations et intensément dramatique, que Zola appelle de ses voeux dès 1866.
Dans un texte célèbre du Roman expérimental , Zola, fort du succès des Rougon-Macquart et de son statut de chef d’école, reviendra longuement sur l’imagination dans le roman, pour en décréter cette fois la déchéance ou tout du moins la subordination au « sens du réel » :
L’imagination n’est plus la qualité maîtresse du romancier. […] J’insiste sur cette déchéance de l’imagination, parce que j’y vois la caractéristique même du roman moderne. Tant que le roman a été une récréation de l’esprit, un amusement auquel on ne demandait que de la grâce et de la verve, on comprend que la grande qualité était avant tout d’y montrer une invention abondante. […] Avec le roman naturaliste, le roman d’observation et d’analyse, les conditions changent aussitôt. Le romancier invente bien encore ; il invente un plan, un drame ; seulement, c’est un bout de drame, la première histoire venue, et que la vie quotidienne lui fournit toujours. Puis, dans l’économie de l’oeuvre, cela n’a plus qu’une importance très mince. Les faits ne sont là que comme les développements logiques des personnages. La grande affaire est de mettre debout des créatures vivantes, jouant devant les lecteurs la comédie humaine avec le plus de naturel possible. Tous les efforts de l’écrivain tendent à cacher l’imaginaire sous le réel [19] .
Avant de stigmatiser les contradictions apparentes entre ce discours critique et les plus célèbres pages, lyriques, mythographiques, fantastiques… des grands romans zoliens, il convient d’examiner le propos. Dans son révisionnisme de l’ inventio , Zola se défie donc de l’imagination débridée, gratuite , et, sans totalement l’exclure, puisque « le romancier invente bien encore », en écrivain classique, il la subordonne à la dispositio (le plan). Sans le dire expressément, il l’affecte en outre à une elocutio de la dissimulation, de la feinte et de l’illusion, puisqu’il faut « cacher l’imaginaire sous le réel ». Cette lecture formaliste du réalisme comme teknè et « discours contraint [20] » prépare les analyses structuralistes des années 1960-1970, comme celle que Roland Barthes appliquera à Sarrasine de Balzac, dans S/Z (1970) : « L’écriture réaliste est loin d’être neutre, elle est au contraire chargée des signes les plus spectaculaires de la fabrication [21] . » Et déjà Maupassant faisait remarquer, dans sa longue préface à Pierre et Jean , que « les Réalistes de talent devraient s’appeler plutôt des Illusionnistes [22] ». En visant l’annihilation du sujet, l’indifférence de la fable , le projet de « livre sur rien » de Flaubert nous engage lui aussi à dépasser les oppositions dans lesquelles Zola se complaît par nécessité doctrinale pour imposer le naturalisme avant tout comme une branche du savoir du temps, un réalisme gnoséologique et l’adaptation des principes du positivisme à la littérature. Si l’on prend la peine de lire des ouvrages « scientifiques » de l’époque, notamment l’ Introduction à l’étude de la médecine expérimentale de Claude Bernard, parue en 1865, on retrouve une même passion du réel, l’apologie exaltée du drame humain, et la ferveur d’une « exploration » du monde qui allie intimement l’observation (jamais passive) et l’expérimentation (jusqu’auboutiste, avec un plaidoyer pour la vivisection) :
La connaissance absolue ne saurait donc rien laisser en dehors d’elle, et ce serait à la condition de tout savoir qu’il pourrait être donné à l’homme de l’atteindre. L’homme se conduit comme s’il devait parvenir à cette connaissance absolue, et le pourquoi incessant qu’il adresse à la nature en est la preuve. C’est en effet cet espoir constamment déçu, constamment renaissant, qui soutient et soutiendra toujours les générations successives dans leur ardeur passionnée à rechercher la vérité [23] .
Le rêve éveillé du réel est donc préféré au réel refoulé du rêve.
La pratique plus franche de l’ art du roman par Flaubert, sa conception du style et son indifférence affichée aux doctrines en vogue – y compris le naturalisme –, nous ramène vers les évidences de la « poétique insciente [24] » à laquelle s’appliquait l’auteur de Salammbô , d’ Un coeur simple ou de L’éducation sentimentale . Flaubert lui aussi est « très difficile », exigeant et sévère dans son appréciation des oeuvres littéraires, mais son goût, tout à fait sûr, puisqu’il le porte vers les chefs-d’oeuvre incontestables de Rabelais, Shakespeare, Hugo… [25] , ne s’embarrasse pas des préoccupations épistémologiques et des réticences zoliennes, puisqu’il engage un jugement de vérité fondé justement sur cette alliance de l’observation et de l’imagination que l’on a coutume d’appeler l’ invention . Même si celle-ci se déploie sur le mode de la caricature, de l’accumulation invasive et du grotesque, jusqu’à l’invraisemblance, elle parviendra au vrai, dit Flaubert. Telle est la leçon du grand art chez Rabelais ou Molière, dont on ne peut pas dire qu’ils ne furent pas d’avisés connaisseurs du genre humain et des réalités de leur époque :
Il ne faut jamais craindre d’être exagéré . Tous les grands l’ont été, Michel-Ange, Rabelais, Shakespeare, Molière. Il s’agit de faire prendre un lavement à un homme (dans Pourceaugnac ) ; on n’apporte pas une seringue ; non, on emplit le théâtre de seringues et d’apothicaires. Cela est tout bonnement le génie dans son vrai centre, qui est l’énorme. Mais pour que l’exagération ne paraisse pas, il faut qu’elle soit partout continue, proportionnée, harmonique à elle-même. Si vos bonshommes ont cent pieds, il faut que les montagnes en aient vingt mille. Et qu’est-ce donc que l’idéal, si ce n’est ce grossissement-là [26] ?
Flaubert écrit ces mots pendant la rédaction tumultueuse, on le sait, de Madame Bovary, qui engage, derrière les apparences d’extrême maîtrise que manifeste le « produit fini », une réflexion fébrile sur les usages de l’imaginaire, du grotesque, sur la précision vériste des scènes clés (celle de l’empoisonnement d’Emma, notamment, pour laquelle Flaubert a consulté Taine) et la nécessité d’une structure d’ensemble. Flaubert connaissait trop bien son penchant romantique à l’imagination échevelée pour, sinon s’en défaire, l’exploiter en en reconnaissant le primat et les possibles usages. Sa position, explicitée à plusieurs reprises, dans les lettres à Louise Colet notamment, n’est pas très éloignée de celle que théorise Victor Hugo dans la préface de Cromwell : le drame , en pariant sur la stylisation du grotesque et du sublime, dépasse les apories de l’imagination gratuite et du réalisme historique. Il fond ensemble le beau et le laid, le haut et le bas, le noble et le trivial, le comique et le tragique… : « le caractère du drame » est ainsi ce que Hugo ne craint pas d’appeler « le réel », qui substitue, par la puissance de rassemblement des facultés, « l’unité d’ensemble » visionnaire – la seule qui vaille – aux balivernes scolastiques que sont les unités de temps, de lieu, etc., « pauvres chicanes que depuis deux siècles la médiocrité, l’envie et la routine font au génie [27] » :
le caractère du drame est le réel ; le réel résulte de la combinaison toute naturelle de deux types, le sublime et le grotesque, qui se croisent dans le drame, comme ils se croisent dans la vie et dans la création. Car la poésie vraie, la poésie complète, est dans l’harmonie des contraires [28] .
La problématique de l’imaginaire opposé/confronté au réel se trouve dépassée par la perspective synthétique d’un réalisme visionnaire à laquelle le créateur Zola, on l’a pressenti, adhère et consent, contre le théoricien, ce qui fait peut-être de lui à la fois un artiste romantique refoulé et un théoricien classique revendiqué. La critique a pointé et exagéré cette double polarité des écritures de Zola, dès son vivant. Elle lui reconnaît la puissance mythographique du romancier authentique et stigmatise ses prétentions scientistes. Le roman expérimental gauchit effectivement des formulations plus anciennes, celles de Mes haines (1866), par exemple, où Zola revendiquait un premier naturalisme tempéramentiel octroyant une large place à la personnalité de l’artiste, en peinture et en littérature. Tandis que Proudhon, partant d’une idée comtienne, exigeait de l’art qu’il entrât dans l’ordre positif des sciences [29] , Zola proclamait avec force l’autonomie et la fantaisie de l’artiste et justifiait un réalisme personnel qu’il n’ira jamais jusqu’à renier :
L’objet ou la personne à peindre sont les prétextes ; le génie consiste à rendre cet objet ou cette personne dans un sens nouveau, plus vrai ou plus grand. Quant à moi, ce n’est pas l’arbre, le visage, la scène qu’on me représente qui me touchent : c’est l’homme que je trouve dans l’oeuvre, c’est l’individualité puissante qui a su créer, à côté du monde de Dieu, un monde personnel que mes yeux ne pourront pas oublier et qu’ils reconnaîtront partout [30] .
Motivée par la défense du peintre Courbet, cette poétique affecte à la mimèsis une double dimension messianique et caractérisante ; elle justifie que le réel soit sélectionné, exhibé et réinterprété par le génie créateur. Quand il a découvert Balzac, dans les années 1860, Zola aurait pu souscrire au jugement connu de Baudelaire sur ce « grand homme dans toute la force du terme [31] » :
J’ai mainte fois été étonné que la grande gloire de Balzac fût de passer pour un observateur ; il m’avait toujours semblé que son principal mérite était d’être visionnaire, et visionnaire passionné. Tous ses personnages sont doués de l’ardeur vitale dont il était animé lui-même. Toutes ses fictions sont aussi profondément colorées que les rêves [32] .
Balzac lui-même, dans le célèbre avant-propos de La Comédie humaine , recourt à l’imagerie séculaire de l’inspiration ou de la visitation pour retracer la naissance de son grand projet :
L’idée première de La Comédie humaine fut d’abord chez moi comme un rêve, comme un de ces projets impossibles que l’on caresse et qu’on laisse s’envoler ; une chimère qui sourit, qui montre son visage de femme et qui déploie aussitôt ses ailes en remontant dans un ciel fantastique. Mais la chimère, comme beaucoup de chimères, se change en réalité, elle a ses commandements et sa tyrannie auxquels il faut céder [33] .
L’intuition, l’imagination, le rêve…, loin d’être repoussés dans les lointains de la création, sont au contraire accueillis comme une prescience , à la fois certitude intime et compétence à fonction de pierre de touche pour valider l’ensemble des apports encyclopédiques et gnoséologiques dont se réclame l’auteur. Parmi ceux-ci, comme pour couronner l’influence des « écrivains mystiques » (Swedenborg, Saint-Martin) et des « plus grands génies des sciences naturelles » (notamment Buffon), il ne faudrait surtout pas négliger Walter Scott pour sa capacité à faire entrer « le merveilleux et le vrai » dans le cadre du roman ancien issu de l’épopée, assurant l’avenir et le succès d’un genre appelé à transcender les clivages génériques des disciplines vouées, chacune dans son ordre, à la connaissance du genre humain. Le roman balzacien ne s’interdit alors pas, comme le laissait pressentir la citation de La femme de trente ans , comme le confirme la lecture de Louis Lambert ou du Chef-d’oeuvre inconnu , de thématiser l’imagination. Les romans de l’art et de l’artiste, en particulier, permettent, mieux que les traités d’esthétique, de saisir les enjeux de la création : éclairés de l’intérieur par la mise en abyme des facultés et dramatisés par des personnages-relais, ils reposent cette question de la dialectique entre le rêve et la réalité, l’imaginaire-désir et l’épreuve du réel. Et nul, mieux que Zola dans L’oeuvre (1886), n’aura réussi à rendre plus « poignante » l’interrogation complexe de la mimèsis, en la reportant sur son personnage de peintre torturé, Claude Lantier, acharné à renouveler la vision même :
Mais ce qui, surtout, rendait ce tableau terrible, c’était l’étude nouvelle de la lumière, cette décomposition, d’une observation très exacte, et qui contrecarrait toutes les habitudes de l’oeil, en accentuant des bleus, des jaunes, des rouges où personne n’était accoutumé d’en voir. Les Tuileries, au fond, s’évanouissaient en nuées d’or ; les pavés saignaient, les passants n’étaient plus que des indications, des taches sombres mangées par la clarté trop vive. Cette fois, les camarades, tout en s’exclamant encore, restèrent gênés, saisis d’une même inquiétude : le martyre était au bout d’une peinture pareille [34] .
Loin de rapporter son réalisme à une division ou à une exclusion des facultés (observation vs invention, analyse vs synthèse…), comme on le croit généralement, Zola a cherché à les subsumer dans un projet dont le mot d’ordre était de « faire vivant » : « L’art n’est autre chose que la réalisation de la plus grande intensité de vie par n’importe quel moyen. Je recrée la vie. J’écris vivant [35] . »
L’idée d’un continuum de la réalité au rêve, vers lequel cette réflexion nous conduit, est au coeur de la réhabilitation de l’imagination par Baudelaire, qui s’en explique dans « La Reine des facultés » ( Salon de 1859) :
C’est l’imagination qui a enseigné à l’homme le sens moral de la couleur, du contour, du son et du parfum. Elle a créé, au commencement du monde, l’analogie et la métaphore. Elle décompose toute la création, et, avec les matériaux amassés et disposés suivant des règles dont on ne peut trouver l’origine que dans le plus profond de l’âme, elle crée un monde nouveau, elle produit la sensation du neuf [36] .
Même débarrassée de son spiritualisme, cette évocation des pouvoirs de l’imagination prépare évidemment les options plus marquées en faveur du surnaturalisme (Huysmans), du symbolisme ou du surréalisme, mais elle rappelle avant tout la nécessité et l’omniprésence de l’image (analogie, métaphore) au coeur même de la démarche artistique, issue, comme le constatait déjà Aristote, à la suite de Platon, d’une alliance subtile de compétences diverses, certaines provenant du naturel de l’artiste et les autres résultant de son travail. Au chapitre xxii de la Poétique , après des considérations sur la lexis (mot difficile à définir : diction, style, discours ?) qui préfigurent la linguistique moderne, Aristote en vient à distinguer la métaphore , qui équivaut à une démarche singulière, éminemment personnelle, inimitable, donc foncièrement non technique (comme le génie) :
S’il est important d’utiliser convenablement chacune des formes dont on a parlé, comme les noms doubles et les noms rares, il est beaucoup plus important de produire des métaphores ; c’est en effet la seule chose qu’on ne peut emprunter à autrui, et cela montre des dons naturels, car faire de bonnes métaphores [ eu metaphorein : bien métaphoriser], c’est observer des ressemblances [37] .
La métaphore, en vérité, n’est donc pas une figure de rhétorique stricto sensu mais, dans l’acte de langage, au plus près et au plus exact, la réalité , débarrassée de ses recommandations usuelles, celles que nos sens font ordinairement prévaloir, à des fins utilitaires, fonctionnelles, que l’on peut qualifier de réalistes , au sens commun , c’est-à-dire conformes à une norme partagée. Dans ses Langages de l’art [38] , Nelson Goodman rappelle l’expérience, relatée par nombre d’ethnographes, dans laquelle on montre une photo nette, figurant une personne, une maison, un paysage familier, à des gens qui vivent dans une culture dépourvue de toute connaissance de la photographie, et les essais des indigènes pour interpréter cet arrangement sans signification de diverses nuances de gris sur une feuille de papier en tenant l’image sous tous les angles possibles ou en la retournant pour examiner la blancheur de la photo. La réalité est ainsi pour nous ce que la norme réaliste positiviste est parvenue à nous faire connaître et accepter : causaliste, logico-déductive, normative et singulièrement armée pour rejeter dans le pathologique et l’interdit tout ce qui contrevient aux modes institués. Pourtant, « La nature est un temple où de vivants piliers/ Laissent parfois sortir de confuses paroles ;/ L’homme y passe à travers des forêts de symboles/ Qui l’observent avec des regards familiers. » Le titre du poème de Baudelaire, Correspondances , swedenborgien, risque d’égarer le lecteur, de lui faire croire que le premier quatrain est dévolu à la correspondance symbolique du monde matériel et du monde spirituel. Les images, où se lisent l’influence d’une culture scolaire qui fonde un néoclassicisme de surface et celles du Génie du christianisme ou de l’abbé Constant [39] (Éliphas Lévi)…, c’est-à-dire des données lisibles (et donc visibles) de l’invisible, sont des pièges qui engagent une lecture rassurante et conventionnelle du thème de la voyance antique et romantique. Harmonieusement dans les vers certes, mais plus brutalement dans le sens conféré, les tercets innovent et imposent une conception toute personnelle, nettement plus subversive, des correspondances : « II est des parfums frais comme des chairs d’enfants,/ Doux comme les hautbois, verts comme les prairies,/ – Et d’autres, corrompus, riches et triomphants »… et cet ensemble de synesthésies « Qui chantent les transports de l’esprit et des sens » se résume dans la coda du dernier vers, qui revendique le continuum harmonique des facultés humaines, y compris des signaux venus des organes. De tradition, on distingue les correspondances des synesthésies. Les premières sont verticales et irréversibles : elles orientent l’homme vers Dieu selon les degrés hiérarchiques d’une spiritualisation. À cet égard elles constituent bien une mystique, au sens strict, c’est-à-dire une méthode, une technique qui permet à l’homme de s’unir à Dieu. Les synesthésies (par exemple l’audition colorée) sont horizontales, et elles font communiquer les sens entre eux. En les privilégiant, Baudelaire revendique un sensualisme agressif et nombre de lecteurs ne s’y sont pas trompés, qui ont dû se retrouver derrière les accusations de « réalisme » et d’outrage aux bonnes moeurs brandies par le procureur Pinard dans son réquisitoire du 20 août 1857 devant la sixième chambre de police correctionnelle du Tribunal de la Seine. L’univers des Fleurs du mal nous est devenu familier mais il n’est pas certain que nous apercevions aussi clairement que les contemporains ce renouvellement copernicien du regard poétique baudelairien, maintenant que la canonisation scolaire a succédé à l’indignation.
Rimbaud avait cependant bien compris dans sa lettre à Demeny du 15 mai 1871 que « Baudelaire est le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu ». Ce concept de voyance métaphorique, avec ses procédures de transfert sémiologique, de « correspondances » horizontales réalistes et non plus verticales idéalistes , est essentiel pour restituer à l’imaginaire sa puissance de traduction et de fécondation du réel, cette belle endormie que seul un talisman artistique peut éveiller et désenvoûter. Zola a raison de postuler la richesse inépuisable du réel et de ne pas se contenter de sa morne idiotie , au sens grec d’ idiôtès : idiot, simple, particulier, unique, existant en soi, naturellement et sans appeler de commentaire particulier, autodéterminé selon les lois de l’insignifiance absolue, absolument quelconque [40] . Si la réalité est intéressante , poignante et humaine, c’est uniquement par le rapport que l’homme établit avec elle. Ce rapport peut bien mimer l’indifférence et l’objectivité, se targuer d’exactitude, il ne parviendra jamais à s’assimiler la matière, le monde, défini de façon profonde par le physicien Ernst Mach comme « un être unilatéral dont le complément en miroir n’existe pas ou, du moins, ne nous est pas connu [41] ». Ainsi, comme l’avait fait remarquer Victor Hugo dans la préface de Cromwell , « la vérité de l’art ne saurait jamais être, ainsi que l’ont dit plusieurs, la réalité absolue . L’art ne peut donner la chose même [42] . » À partir de ce constat, finalement élémentaire, et aussi décevant soit-il, il conviendra d’accepter que les oeuvres littéraires, faites avec des mots, donnent naissance à des quasi-mondes et soient des objets relationnels faisant une large part, par les variations qu’ils autorisent, à de multiples définitions du réel, y compris celles qui ont recours à l’imaginaire, soit pour montrer ce que l’on ne voit pas habituellement soit pour préparer, par la voyance, l’utopie, la libération de diverses forces mentales, la venue d’autres valeurs, et effectivement un autre monde. De toute façon, « l’homme fuit l’asphyxie » (René Char, Argument de L’Avant-Monde , dans Fureur et Mystère ). Le poète, entre tous, « est vraiment voleur de feu » : « Il est chargé de l’humanité, des animaux même ; il devra faire sentir, palper, écouter ses inventions ; si ce qu’il rapporte de là-bas a forme, il donne forme ; si c’est informe, il donne de l’informe [43] . » Loin d’être un exercice scolastique, une simple rêverie émanant du narcissique poète subjectif condamné au début de la lettre à un Izambard émule de Musset et « victime du livre [44] », le poème, se dégageant de l’autotélisme oiseux de l’art pour l’art, « sera de l’âme pour l’âme, résumant tout, parfums, sons, couleurs, de la pensée accrochant la pensée et tirant [45] ». C’est bien à la conception de la « langue » baudelairienne que fait alors référence la voyance rimbaldienne, dans le sillage des expériences conduites par le Poe des Histoires extraordinaires et le Nerval d’ Aurélia (1855).
Voici donc substitué l’ordre ouvert de l’imaginaire à un imaginaire de l’ordre restrictif dans lequel on enferme souvent la réflexion sur l’art comme moyen d’accéder au vrai. Un auteur classique comme La Fontaine avait déjà montré, en se réclamant du Phédon et des allégories didactiques intégrées à sa maïeutique par Socrate, l’intérêt du détour par l’imaginaire et la fiction pour asseoir « le pouvoir des fables » ( iv , 8) :
Il n’y a point de bonne poésie sans harmonie ; mais il n’y en a point non plus sans fiction ; et Socrate ne savait que dire la vérité. Enfin il avait trouvé un tempérament : c’était de choisir des fables qui continssent quelque chose de véritable, telles que sont celles d’Ésope [46] .
Loin d’être maîtresse de fausseté, folle du logis, « trouble » ou « fureur » [47] , l’imagination peut parfaitement s’harmoniser à un propos équilibré, mesuré, pour dire des vérités éthiques aussi efficacement que les sciences exactes dans leur champ d’emploi. « Un animal dans la lune » ( vii , 17) est explicite sur ce point central de la poétique de La Fontaine. Dans cette grande fable épistémologique, qui exploite un fait divers contemporain, celui d’« une souris cachée entre les verres » d’une lunette astronomique, le poète dessine les contours d’une herméneutique heureuse, qui sert à bien lire les fables et sait mettre à profit les pouvoirs conjugués du sens de l’observation (les organes des sens), un jugement sain (la raison) et une suffisante ouverture d’esprit (l’imagination). Jean-Paul Sartre, dans ses travaux sur l’imagination, a suffisamment démontré que s’il y a là une grande fonction « irréalisante », elle n’en relevait pas moins de la « conscience », non pas inertie ou passivité mais, proche du mot allemand de Bewusstein , une structure intentionnelle, utile par nature. La preuve en est, dans l’expérience de lecture ordinaire d’un roman, l’adresse avec laquelle on remplit , on comble les lacunes d’une information nécessairement réduite et éparse, quelle que soit la qualité des descriptions « réalistes ». C’est sans doute l’une des raisons pour lesquelles Flaubert refusait que l’on illustrât ses romans :
Jamais, moi vivant, on ne m’illustrera, parce que la plus belle description littéraire est dévorée par le plus piètre dessin. Du moment qu’un type est fixé par le crayon, il perd ce caractère de généralité, cette concordance avec mille objets connus qui font dire au lecteur : « J’ai vu cela » ou « Cela doit être ». Une femme dessinée ressemble à une femme, voilà tout. L’idée est dès lors fermée, complète, et toutes les phrases sont inutiles, tandis qu’une femme écrite fait rêver à mille femmes. Donc, ceci étant une question d’esthétique, je refuse formellement toute espèce d’illustration [48] .
Nous avons besoin de la fonction imageante pour combler les « trous » de la narration et, par la puissance d’évocation qui nous est propre, relayer le travail du créateur. C’est donc bien par l’imagination que nous sommes co-auteurs. Attribuer une intentionnalité à l’imagination, c’est aussi rappeler qu’elle ne peut être « pure », au sens où l’entend Zola qui, comme les « psychologues » de son temps, cède à l’illusion de l’immanentisme. Une image n’est rien d’autre qu’un rapport, y compris un rapport au monde, comme l’a fait remarquer Bachelard dans ses divers ouvrages, indispensables pour faire progresser la réflexion sur cette question. Et ainsi, parmi tant d’autres, on aura recours à cette remarque essentielle, qui prépare l’analyse de l’univers « liquide » d’Edgar Poe :
L’imagination n’est pas, comme le suggère l’étymologie, la faculté de former des images de la réalité ; elle est la faculté de former des images qui dépassent la réalité, qui chantent la réalité. Elle est une faculté de surhumanité. Un homme est un homme dans la proportion où il est un surhomme. On doit définir un homme par l’ensemble des tendances qui le poussent à dépasser l’humaine condition. Une psychologie de l’esprit en action est automatiquement la psychologie d’un esprit exceptionnel, la psychologie d’un esprit que tente l’exception [49] .
Lancés sur la voie de la réhabilitation des puissances de l’imagination, nous aurions dû évidemment poursuivre, pour affirmer « la nécessité du rêve », dans une sorte de cheminement chronologique visant l’émancipation définitive, par l’examen des célèbres déclarations des Manifestes du surréalisme d’André Breton. Il est vrai que cette école en a appelé avec ferveur, jusqu’à fonder une nouvelle doxa , au dépassement des catégories qui entravent le fonctionnement d’un esprit humain rendu enfin à ses propres forces, à l’imagination et même aux puissances de l’inconscient. Les conceptions habituelles, classique, documentaire, naturaliste, normative… du réalisme ressortent très modifiées de cette révision, voire de ce révisionnisme des facultés humaines convoquées au tribunal de la modernité par les avant-gardes qui font de la liquidation des vieilles lunes et des valeurs passées le préalable de la révolution. Mais nous avons d’abord voulu situer la remarque de Zola en son temps ; ce faisant, nous avons constaté qu’elle oblige à revenir sur les clichés qui obscurcissent et radicalisent la question centrale du pouvoir de l’art à prendre en charge le réel. Qu’il y ait là fondamentalement une illusion , certes, et l’illusion réaliste n’est pas la moindre, puisqu’elle reproduit les pièges de la spécularité, qu’elle construit et entretient une croyance sur le monde, en sélectionnant ce qui relève du phénoménal et, pour ce qui ne se voit pas (la « psychologie » des personnages, par exemple), ce qui se prévoit justement, en postulant l’irrationalité du rêve, de la fiction gratuite, de la fantaisie… pourtant indéniablement compris dans ces réussites artistiques que sont La comédie humaine ou Les Rougon-Macquart (qui inclut, remarquons-le, un assez étrange roman sur Le rêve ). Une fois admise l’inséparabilité des facultés et leur collaboration active plutôt que leur sélection, le champ de l’appréciation des oeuvres d’art, romans, poèmes, tableaux… est ouvert à un amateur qui n’est pas sommé de préférer telle ou telle « production » sur la base de convictions dogmatiques exclusives. Il n’y a, on s’en doute, aucune raison valable d’être « très difficile » pour des oeuvres diverses qui valent avant tout, quand elles l’atteignent, pour une vérité autonyme qui s’excepte assez mystérieusement, reconnaissons-le, de la plupart de ses déterminations, y compris celles que revendiquent les créateurs.
Parties annexes
Note biographique.
Professeur en classes préparatoires aux grandes écoles (Bordeaux, France), spécialiste de Zola et du naturalisme, auteur de Zola critique littéraire (Paris, Honoré Champion, 2003), François-Marie Mourad est membre de l’équipe Zola de l’ item-cnrs et du comité de rédaction des Cahiers naturalistes . De Zola, il a édité, entre autres, Le roman expérimental (Paris, GF-Flammarion, 2006), Mes haines (Paris, GF-Flammarion, 2012), La Confession de Claude (Paris, Classiques de poche, 2014) et La curée (Paris, GF-Flammarion, 2015).
Ce grand quotidien parisien a été fondé en 1865 par Hippolyte de Villemessant (également fondateur et directeur du Figaro ) pour faire concurrence au très populaire Petit Journal et lui confisquer « sa couche de lecteurs intelligents ». Zola, alors journaliste et courriériste littéraire, y tiendra une chronique régulière, les « Livres d’aujourd’hui et de demain » (125 articles, du 1 er février au 7 novembre 1866), et y publiera un de ses premiers romans, Le voeu d’une morte (du 1 er au 26 septembre 1866).
Article publié le 8 mai 1866. Reproduit dans Émile Zola, Oeuvres complètes (éd. Henri Mitterand), t. x , Paris, Cercle du Livre précieux, 1968-1970, p. 474-475. Désormais abrégé en ( OC ), suivi du numéro du tome cité, puis de la page.
À distinguer de l’ imaginatio , reproductive du réel (donc conçue dans l’orbe d’une reconnaissance sur fond de connaissance première, par la perception notamment).
Sainte-Beuve, « De la littérature industrielle » ( Revue des Deux Mondes , 1 er septembre 1839), dans Pour la critique , Paris, Gallimard, coll. « folio essais », 1992, p. 197-222.
La loi du 28 juin 1833, dite loi Guizot, en organisant l’enseignement primaire, a jeté les bases de la croissance d’un public de lecteurs nouveaux, au-delà des cercles urbains et lettrés traditionnels qui formaient l’essentiel du public sous la Révolution et la Restauration. Cette réforme postule « l’universalité de l’instruction primaire » par la lecture, l’écriture et le calcul élémentaire. Grâce à elle, la France s’est alphabétisée : en 1832, on dénombre 53 % d’analphabètes, en 1848 les deux tiers des conscrits savent lire, écrire et compter.
Sainte-Beuve, art. cit., p. 212.
Thomas Pavel, L’art de l’éloignement. Essai sur l’imagination classique , Paris, Gallimard, coll. « Folio-essais », 1996. Cet essai « part de l’observation qu’à l’âge classique les mondes décrits par la littérature s’éloignaient considérablement de la réalité empirique de la vie quotidienne » (avant-propos, p. 13). Des ouvrages comme L’Astrée , Artamène ou le Grand Cyrus , Daphnis et Chloé entrent parfaitement dans le champ des « oeuvres de pure imagination » qu’évoque Zola.
Miguel de Cervantes, L’ingénieux Hidalgo Don Quichotte de la Manche (trad. A. Schulman), t. 1, Paris, Éditions du Seuil, 1997 [1605-1615], p. 57 (chapitre i ).
« Je relis, en ce moment, Don Quichotte . Quel gigantesque bouquin ! Y en a-t-il un plus beau ? », lettre à George Sand du 23 février 1869, Correspondance de Gustave Flaubert, (éd. Bruneau), t. iv , Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1998, p. 25. Don Quichotte aurait été le premier livre lu à Flaubert, si l’on en croit sa nièce Caroline (dans ses Souvenirs intimes ).
Flaubert, Madame Bovary , dans Oeuvres complètes , Paris, Éditions du Seuil, coll. « L’intégrale », 1964, p. 586.
Balzac, La comédie humaine (éd. Pierre-Georges Castex), t. ii , Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 1037.
Roland Barthes, « Littérature objective », Essais critiques (1964), reproduit dans Oeuvres complètes (éd. Éric Marty), t. i , Paris, Éditions du Seuil, 1993, p. 1185-1186.
Alain Robbe-Grillet, Les gommes , Paris, Éditions de Minuit, 1953, p. 161.
Zola, Le ventre de Paris , dans Les Rougon-Macquart , (éd. Henri Mitterand), t. i , Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1960, p. 614.
Zola, La curée , op. cit. , p. 356.
Ibid. , p. 357.
Zola, « Le Sens du réel », premier exposé de la section « Du roman », dans Le roman expérimental , Paris, GF-Flammarion, 2006 [1881], p. 203-204.
Philippe Hamon, « Un discours contraint », dans Littérature et réalité , Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points », 1982, p. 119-181 et, plus récemment, sous sa direction, Le signe et la consigne. Essai sur la genèse de l’oeuvre en régime naturaliste. Zola , Genève, Droz, 2009.
Affirmation qui se retrouve dans Le degré zéro de l’écriture , Paris, Gonthier, coll. « Bibliothèque Médiations », 1965 [Paris, Éditions du Seuil, 1953], p. 59.
Guy de Maupassant, « Le roman », préface à Pierre et Jean , dans Romans (éd. Albert-Marie Schmidt), Paris, Albin Michel, 1975 [1887], p. 835.
Claude Bernard, Introduction à l’étude de la médecine expérimentale , Paris, Flammarion, 1984 [1865], p. 125.
« Quand sera-t-on artiste , rien qu’artiste, mais bien artiste ? Où connaissez-vous une critique qui s’inquiète de l’oeuvre en soi , d’une façon intense ? On analyse très finement le milieu où elle s’est produite et les causes qui l’ont amenée. – Mais la poétique insciente , d’où elle résulte ? Sa composition, son style ? Le point de vue de l’auteur ? Jamais !
Il faudrait pour cette critique-là une grande imagination et une grande bonté, je veux dire une faculté d’enthousiasme toujours prête. – Et puis du goût, qualité rare, même dans les meilleurs, si bien qu’on n’en parle plus, du tout ! » Lettre du 2 février 1869, dans Correspondance de Flaubert, t. iv , p. 15.
Voir Michel Martinez, Entre le sphinx et la chimère. Flaubert lecteur, critique et romancier , Paris, L’Harmattan, 2000.
Lettre à Louise Colet du 14 juin 1853, Correspondance , t. ii , p. 356. (C’est l’auteur qui souligne.)
Victor Hugo, préface de Cromwell , dans Oeuvres complètes (éd. Jean Massin), t. iii , Paris, Club français du livre, 1967, p. 64.
Ibid. , p. 60.
« Nous pouvons espérer de parvenir un jour à une théorie du beau, d’après laquelle la peinture, l’architecture et la statuaire seraient traitées comme des sciences exactes, et la composition artistique assimilée à la construction d’un navire, à l’intégration d’une courbe, à un calcul de forces et de résistances. C’est alors que l’artiste, jadis homme d’imagination et de foi, devenant homme de raisonnement et de science, brillerait au premier rang de la sphère de la raison pure », Pierre-Joseph Proudhon, De la création de l’ordre dans l’humanité, ou Principes d’organisation politique , Paris, Garnier frères, 1849 [1843], p. 191-192.
Zola, « Proudhon et Courbet », Mes haines , Paris, GF-Flammarion, 2012 [1866], p. 69.
Baudelaire, « Les contes de Champfleury », dans Oeuvres complètes (éd. Claude Pichois), t. ii , Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 22.
Baudelaire, « Théophile Gautier », op. cit. , p. 120.
Balzac, avant-propos de La comédie humaine , t. i , p. 7.
Dans Les Rougon-Macquart , t. iv , p. 206.
Cité par Colette Becker dans Zola. Le saut dans les étoiles , Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2002, p. 163.
Baudelaire, Salon de 1859, op. cit. , p. 621.
Aristote, Poétique (trad. O. Bellevenue et S. Auffret), Paris, Mille et une nuits, 1997, p. 54.
Nelson Goodman, Langages de l’art ( trad. J. Morizot), Paris, Hachette Littératures, 1990.
Qui a écrit en 1845 un poème intitulé Les correspondances . Baudelaire, significativement, s’abstient de déterminer ses propres correspondances.
Voir Clément Rosset, Le Réel. Traité de l’idiotie , Paris, Éditions de Minuit, coll. « Reprise », 2009 [1997].
Cité par C. Rosset, op. cit. , p. 43.
Préface de Cromwell , op. cit. , p. 70.
Rimbaud, lettre à Paul Demeny du 15 mai 1871, dans Poésies (éd. Louis Forestier), Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 1999, p. 91.
Jules Vallès, « Les Victimes du livre », article paru dans Le Figaro , le 9 octobre 1862, donc à peu près contemporain de l’article de Zola. L’influence de Musset est dénoncée avec virulence par Vallès. Voir Oeuvres (éd. Roger Bellet), t. i, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, p. 242-243.
Rimbaud, lettre du 15 mai 1871, op. cit. , p. 92.
La Fontaine, préface à ses Fables (éd. Marc Fumaroli), Paris, Le Livre de poche, coll. « La pochothèque », 1985, p. 6.
Montaigne, Essais , i , 20, « De la force de l’imagination », dans l’édition de 1595 qui sert de base à l’édition établie par Jean Balsamo, Catherine Magnien et Michel Magnien, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2007, p. 98-109.
Flaubert, lettre du 12 juin 1862 à Ernest Duplan, Correspondance , t. iii , p. 221-222.
Gaston Bachelard, L’eau et les rêves. Essai sur l’imagination de la matière , Paris, Corti, 1942, p. 15.
Outils de citation
Citer cet article, exporter la notice de cet article.
RIS EndNote, Papers, Reference Manager, RefWorks, Zotero
ENW EndNote (version X9.1 et +), Zotero
BIB BibTeX, JabRef, Mendeley, Zotero
Fiche sur L’Assommoir de Zola : Résumé et analyse du roman
Zola s'intéresse dans L'Assommoir à la dégradation de la société et à la déchéance des êtres. Les ouvriers-artisans parisiens, victimes de leurs conditions de vie et de l'alcoolisme, sont matière à l'étude d'une nouvelle forme de fatalité, méconnue jusqu'alors de la littérature : le milieu et l'hérédité. Avec L'Assommoir , Zola connut le succès, peut-être à cause du scandale que le roman provoqua, et malgré les critiques des journaux de gauche ou de droite. Ce livre, salué par Huysmans, Mallarmé et Bourget, apporta à son auteur l'argent et la gloire qu'il convoitait.
I- RÉSUMÉ DE L'ASSOMMOIR DE ZOLA
Gervaise Macquart, fille d’Antoine Macquart, a quitté Plassans et la Provence, avec son amant Auguste Lantier et ses deux bâtards, Claude et Etienne, pour tenter sa chance à Paris. Mais Lantier abandonne la jeune femme pour Adèle, une brunisseuse* en chambre. Après un combat homérique qui l’oppose à Virginie, la soeur d’Adèle, au beau milieu du lavoir, Gervaise se retrouve seule à l’hôtel Boncoeur, un garni sordide de Montmartre. Cependant, pressée par son voisin Coupeau, un ouvrier zingueur, d’accepter la vie commune, elle consent au mariage. Mais Mme Lorilleux, la sœur de Coupeau, réprouve cette union et fait un accueil glacé à Gervaise. La noce se déroule sous de funestes auspices : il pleut. Pour tromper l’ennui, on se réfugie au Louvre, sous la conduite de M. Madinier, un ancien ouvrier devenu patron. Déplacés au milieu des ors et des chefs-d’œuvre qu’ils ne comprennent pas, les forgerons, les blanchisseuses et les concierges errent lamentablement dans le labyrinthe des salles, ponctuant leur visite de commentaires naïfs ou égrillards qui offusquent jusqu’ aux gardiens.
Après un repas minable au Moulin d’Argent, les noceurs se séparent, furieux d’avoir dû payer des suppléments et ce mariage bâclé laisse à Gervaise le goût amer de l’échec. Cependant le ménage est uni. Travailleurs, les deux jeunes gens gagnent une petite aisance et peuvent s’installer dans leurs meubles, rue Neuve-de-la-Goutte-d’Or, tout près de chez Goujet, un jeune forgeron qui vit avec sa mère. Bientôt naît une petite fille, Nana. Mais Cou- peau, jusqu’alors bon mari et bon père, tombe d’un toit et voilà l’ouvrier zingueur gâté par l’oisiveté forcée à laquelle le contraint son accident.
Gervaise, qui a dépensé toutes ses économies pour éviter l’hôpital à son homme, désespère de jamais ouvrir la boutique de blanchisseuse de fin* à laquelle elle rêvait. Mais le forgeron Goujet, secrètement amoureux d’elle, lui prête cinq cents francs qui lui permettent de s’installer au rez-de-chaussée de la grande maison de la rue de la Goutte-d’or, avec trois ouvrières.
Voulant prendre sa revanche sur ses pauvres noces où les Lorilleux l’ont humiliée, elle s’endette pour les régaler d’un formidable gueuleton. Mais la fête qui consacre son triomphe marque le début de sa chute. Depuis des semaines en effet, Virginie, qui a fait mine de se réconcilier avec elle, l’entretient de Lantier. Quand le chapelier fait irruption dans la boutique où l’on a dressé la table, Gervaise est déjà prête à céder à ses anciennes amours.
Bientôt Coupeau, aveugle ou complaisant, installe Lantier dans la blanchisserie et Gervaise, écœurée par l’ivrognerie de son mari, redevient la maîtresse du chapelier. De plus en plus gourmande et paresseuse, ruinée par ses deux hommes oisifs qui lui mangent sa boutique, elle doit céder son bail à Virginie et rejoint le coin des pouilleux, au sixième étage.
Rejetée de tous, elle sombre à son tour dans la boisson tandis que Nana, d’abord apprentie fleuriste, quitte le bouge familial et devient fille de joie. Gervaise tombe alors dans l’hébétude épouvantable de l’absinthe : après avoir assisté à la mort de Coupeau, victime d’une crise de delirium tremens, elle sombre peu à peu dans la folie et meurt de faim et de misère.
II- ANALYSE DE L'ASSOMMOIR
A - un roman réaliste, 1. « le premier roman sur le peuple qui ne mente pas ».
Accusé par Hugo de montrer « comme à plaisir les hideuses plaies de la misère et de l’abjection à laquelle le pauvre se trouve réduit », l’auteur s’en défend dans la Préface du volume : « L’Assommoir est le premier roman sur le peuple qui ne mente pas et qui ait l’odeur du peuple », affirme-t-il.
Vigoureusement opposé à l’idéalisme de Hugo , chez qui l’ancien forçat Jean Valjean devient tout à la fois un saint laïc et un chef d’entreprise riche à millions, Zola entreprend une œuvre de vérité sans complaisance.
2. La documentation
La pauvreté, il la connaît pour avoir habité les mansardes du Quartier latin au temps de sa jeunesse, il connaît la danse devant le buffet vide et les vêtements portés au mont-de-piété ; il connaît aussi les mœurs populaires par sa famille maternelle et par sa femme, Gabrielle-Alexandrine Meley, qui fut peut-être lingère ou fleuriste ; il connaît surtout la vie ouvrière par une abondante documentation et, en particulier, par le livre d’un ancien ouvrier devenu fabricant boulonnier, Denis Poulot, auteur du Sublime ou l’Ouvrier tel qu’il est en 1870 dont on retrouve ici bien des échos.
3. Un roman expérimental
Mais, au-delà du réalisme documentaire, on trouve dans L ‘Assommoir une illustration de la théorie du roman expérimental : prenons des ouvriers ni pires ni meilleurs que d’autres, plongeons-les dans le milieu délétère des faubourgs, soumettons-les à une épreuve (l’accident qui condamne Coupeau à l’oisiveté, le retour de Lantier qui réveille les fantômes du passé), et voyons comment ils réagissent en fonction de leur hérédité et de leur tempérament.
B- Le milieu, l'hérédité et le tempérament dans L'Assommoir
1. le milieu empesté du faubourg.
Le Paris de L’Assommoir, c’est celui des barrières, des murs d’octroi qui entourent la ville d’une bande de désert propice à tous les trafics du plaisir et du crime : le bal du Grand Balcon et les « cris d’assassinés » qu’on y entend parfois en témoignent. Ce faubourg pestilentiel où souffle la puanteur des abattoirs, où l’on construit l’hôpital Lariboisière, installe au début du roman un sombre horizon d’attente : abandonnée par Lantier dans le trou sordide de l’hôtel Boncoeur, Gervaise a le pressentiment de son destin, « comme si sa vie, désormais, allait tenir là, entre un abattoir et un hôpital ».
2. Les assommoirs
Et Gervaise a vu juste. Comme les bêtes qu’on assomme dans les abattoirs, elle va être assommée par le milieu putride du faubourg. L’Assommoir du père Colombe résume à lui seul les influences maléfiques qui vont s’acharner contre elle. Avec sa « mine sombre » et ses « serpentins descendant sous terre », avec ce ronflement sourd, ce « souffle intérieur » qu’aucune fumée ne dénonce, l’alambic est l’emblème démoniaque des causalités souterraines du milieu. D’emblée, Gervaise est prise d’un frisson devant « la cuisine du diable» de la machine à soûler.
«Travailleur morne, puissant et muet », infatigable, l’alambic capture la force de travail de ceux qui se laissent prendre à son air bonhomme, à « ce gros bedon de cuivre » qui fait l’orgueil de la maison. Mais l’Assommoir, ce n’est pas seulement le café du père Colombe où l’on s’assomme à coups d’absinthe, c’est aussi le lavoir, où Gervaise et Virginie s’assomment à coups de battoir, c’est encore la grande maison insalubre de la Goutte-d’or, c’est enfin la boutique surchauffée où s’entasse le linge sale avec ses puanteurs et ses malpropretés morales.
3. Un sou jeté en l’air, retombant pile ou face
Au déterminisme du milieu, Gervaise et Coupeau opposent d’abord un beau courage, mais, victimes d’une hérédité gâtée, ils abdiqueront bientôt. Fille de l’ivrogne Macquart, Gervaise boite d’avoir été conçue dans l’ivresse brutale de son père mais c’est surtout la volonté, en elle, qui est boiteuse : « elle se comparait à un sou lancé en l’air, retombant pile ou face, selon les hasards du pavé », écrit Zola. Quant à Coupeau, avec sa face de « chien joyeux et bon enfant », avec « son adresse et son effronterie de singe », il garde quelque chose de l’animalité primitive. Or, pour Zola, lecteur de Darwin, seuls les êtres les plus évolués sont capables de volonté.
C - Du peuple laborieux au prolétariat corrompu
1. leçons de tempérance.
De leur ascension sociale à leur déchéance, les Coupeau vont donc parcourir tous les degrés qui vont du peuple laborieux au prolétariat corrompu : l’installation du couple rue Neuve-de-la Goutte-d’or, auprès des Goujet, s’accompagne d’une longue période de tempérance. La tempérance, c’est le refus de tous les excès, c’est aussi un usage moral du temps. Le culte religieux que Gervaise voue à sa pendule, « comme si le marbre de sa commode [s’était] transformé en chapelle », symbolise les vertus prolétariennes du temps de travail accumulé, capitalisé sur le livret de caisse d’épargne caché sous le globe de verre. Lorsque la blanchisseuse, retombée aux bras de Lantier, aura fait son deuil de la dignité, la pendule sera portée au mont-de-piété dans le minuscule cercueil d’une caisse à chapeau.
2. La fête de l’oie
La fête de l’oie est le premier pas vers l’intempérance : c’est dans la boutique que l’on dresse la table et déjà les taches de graisse et de vin souillent l’établi. Voulant écraser les Lorilleux de ses largesses, la blanchisseuse n’hésite pas à envoyer Maman Coupeau au clou pour emprunter sur son alliance ; et, dans ces ripailles rabelaisiennes où le vin coule comme « un vrai ruisseau, lorsqu’il a plu et que la terre a soif », où l’on voit les bedons se gonfler à mesure, tout s’inverse brusquement:
leurs « faces pareilles à des derrières », les convives, déshumanisés, dévorent à belles dents l’animal du sacrifice, Gervaise elle-même, dont chacun semble emporter un morceau. Car, avec sa belle « peau de blonde », l’oie n’est qu’une métaphore de la blanchisseuse: les Lorilleux « auraient englouti le plat, la table et la boutique afin de ruiner la Banban d’un coup et, toute la nuit, un chat, croquant les os, acheva d’enterrer la bête avec le petit bruit de ses dents fines... ».

3. De la Saint Lundi...
Réintroduit dans la boutique à la fête de Gervaise, Lantier va y apporter le ferment de la corruption de l’espace et du temps. Prenant la chambre d’Etienne, il oblige d’abord la blanchisseuse à « fourrer le linge sale », entassé dans la chambre du petit, sous son propre lit: dès lors, accoutumée à l’odeur du vice, Gervaise se laisse aussi aller à la paresse, à l’adultère et à la dette. La puanteur du linge, métonymique* de toutes celles du faubourg, la pénètre par tous les pores de la peau. Désormais, son plaisir est de «rester en tas >, ses outils filent au mont-de- piété, tandis que Lantier, sous prétexte de refuser l’exploitation, entraîne Coupeau dans d’interminables bordées de café en café. Peu à peu, la flâne devient l’obsession du couple : fêtant « la Saint Lundi » des semaines entières, « invent[ant] des saints au calendrier », ils descendent au dernier degré de l’abjection.
4. …à la dernière fête
Les Coupeau se transforment alors en types de carnaval pathétiques pris dans l’hallucination de la fête. Fascinée par son ombre qui danse un chahut de tous les diables sur le boulevard (ch. XII), Gervaise retrouve Coupeau, « déguisé en un qui va mourir », agonisant à l’hôpital Sainte-Anne (ch. XIII). Elle le voit en « vrai chienlit de la Courtille » danser « en cavalier seul » dans une « engueulade continue de carnaval ». La perception de Gervaise est ainsi remarquablement accordée au délire de Coupeau car lui aussi revit cette mascarade de barrière «Tiens [...j c’est la bande de la chaussée Clignancourt, déguisée en ours V1à la cavalcade. » Tous les loisirs populaires, le cirque, la ménagerie, les bals de barrière, le guignol, la foire sont convoqués : Coupeau, s’approchant du mur, y voit son double grimaçant, une tête de singe prêt à le dévorer comme dans un miroir déformant tournant le dos à Gervaise, il la voit aussi se « ficher de lui en public» avec le chapelier comme dans un miroir magique. Et bientôt Gervaise va reprendre elle-même, en miroir, la gesticulation frénétique de son homme, tremblant des pieds et des mains, faisant Coupeau pour les voisins.
D - La culture populaire et le travail du style dans L'Assommoir
1. ethnographie et linguistique.
Cette dernière fête achève l’exploration de la culture populaire qu’a tentée Zola dans un roman de l’alcoolisme qui est aussi une étude ethnographique : on y apprend comment on se marie, comment on vit et comment on meurt dans le petit peuple des faubourgs. On y apprend aussi comment on parle. Certes, l’argot est un fait littéraire massif au XIX siècle : Hugo prête à Gavroche « cet idiome abject qui ruisselle de fange » (Les Misérables) et Balzac analyse « la langue des grecs, des filous, des voleurs et des assassins » (Splendeurs et Misères des courtisanes). Pourquoi donc s’être fâché contre les mots de L’Assommoir ?
2. Le coup de gosier de Paris et le style indirect libre
C’est que Zola n’a pas la prudence de distinguer comme eux la voix du personnage et celle du narrateur. Bafouant toutes les conventions, il ose « couler dans un moule très travaillé la langue du peuple ». En effaçant les marques de subordination, le style indirect libre donne à la troisième personne une valeur flottante qui confond toutes les voix : « Elle en arrivait, les matins de fringale, à rôder avec les chiens [.1 », lit-on au chapitre XII ; « ça répugne les délicats, cette idée mais si les délicats n’avaient rien tortillé de trois jours, nous verrions un peu s’ils bouderaient contre leur ventre ; ils se mettraient à quatre pattes et mangeraient aux ordures comme les camarades. » Qui parle ? Est-ce Gervaise, est-ce Zola ? La leçon n’a pas été du goût des nantis...
Plus d'articles sur L'Assommoir de Zola :
Bac de français; Zola; Le roman naturaliste
Commentaire de texte : L’Assommoir (Chapitre II)
Dissertation: Le roman naturaliste de Zola et Maupassant entre vérité et illusion
Fiche : Le réalisme et le naturalisme (Seconde moitié du XIXe siècle)
Pour aller plus loin:
Adaptation cinématographique:
- Concours Écoles Agro Véto
- Concours Écoles d'ingénieurs
- Concours Écoles de commerce
- Concours Écoles de journalisme
- Concours Enseignement
- Concours Fonction publique : Administration
- Concours Fonction publique : Culture, Patrimoine
- Concours Fonction publique : Défense, Police, Justice
- Concours Fonction publique : Economie, Finances, Douanes, Travail
- Concours Fonction publique : Education, Animation, Sport, Social
- Concours Fonction publique : Technique, Sciences
- Concours IEP /Sciences Po
- Concours Santé Paramédical Social
- Diplômes comptables
- Ecoles d'Art / Architecture
- Réussir à l'université / IAE
- Réussir le Brevet des collèges (DNB)
- Réussir les tests de langues
- Réussir son BTS
- Réussir son BUT
Résumés d'œuvres Zola – Bac Français
Polémiste célèbre – notamment à cause de son article J'accuse sur l'affaire Dreyfus, Emile Zola a écrit plusieurs romans de qualité dont L'Assommoir (1877), Au Bonheur des Dames (1883), Germinal (1885). Chef de file du mouvement naturaliste, il s'appliquera à décrire les faits et la nature comme ils se présentent sans les enjoliver.
- La bête humaine
Plan de la fiche :
1. Contexte de création 2. Résumé
L’Assommoir
1. Contexte de création 2. Comment définir le projet de Zola ? 3. Résumé
- Au bonheur des Dames
1. Renée ou les fastes du monde 2. L'arrivée d'Aristide Rougon à Paris 3. Maxime et Renée 4. L'inceste 5. La nouvelle Phèdre 6. L'ultime spectacle 7. Le triomphe de Saccard et Maxime
Fiches de révisions : Résumés d'œuvres Zola – Bac Français
- L'Assommoir
Décrochez votre Bac 2024 avec Studyrama !
- Poursuivre ses études après le bac
- Fiches de révision du Bac 2024
- Bac 2024 : les dates et épreuves
- Les sujets et corrigés du Bac 2024
- Que faire avec ou sans le bac...
- Résultats du Bac 2024 : dates, heures et résultats par académies
Salons Studyrama
Salon des etudes supérieures de paris - où s'inscrire encore , salon studyrama sup’alternance et apprentissage – spécial rentrée, salon studyrama des etudes supérieures de chambéry.
Rencontrez en un lieu unique tous ceux qui vous aideront à bien choisir votre future formation ou à découvrir des métiers et leurs perspectives : responsables de formations, étudiants, professionnels, journalistes seront présents pour vous aider dans vos choix.
🎁 Dernière ligne droite ! -25% avec le code JEVEUXMONBAC2024 ! 😊
Emile Zola, Germinal
Situations difficiles pour réfléchir • Commentaire
fra1_1511_11_06C
Question de l'homme
Nouvelle-Calédonie • Novembre 2015
Séries ES, S • 16 points
Situations difficiles pour réfléchir
Commentaire
▶ Vous ferez le commentaire du texte de Zola (document B).
Se reporter au document B du sujet sur le corpus .
Les clés du sujet
Trouver les idées directrices
Faites la « définition » du texte pour trouver les axes (idées directrices).
Extrait de roman ( genre ) naturaliste ( mouvement ) qui décrit et raconte ( types de texte ) une manifestation de mineurs en grève ( thème ),épique, tragique ( registre ) spectaculaire, pictural, presque cinématographique, esthétique, réaliste, violent, visionnaire, plein d'émotion ( adjectifs ), pour émouvoir le lecteur, pour rendre compte des conditions des mineurs et de leur détermination ( buts ).
Pistes de recherche
Première piste : une scène spectaculaire, esthétiquement travaillée.
Essayez de visualiser la scène.
Qu'est-ce qui en fait un véritable tableau ? Quels en sont les différents « sujets », les composantes ? les différents « plans » ? les différentes couleurs ?
Un tableau en mouvement : étudiez par quels moyens Zola donne vie à ce tableau ? Pourquoi ce texte serait-il facile à transposer à l'écran ?
Deuxième piste : L'horreur et l'amplification d'une épopée symbolique et prophétique
Montrez la dimension épique de la scène.
Quels sont les éléments visionnaires, merveilleux ? Analysez les images, les transformations presque fantastiques des éléments de la scène.
Étudiez les procédés de l' amplification .
De quoi ce cortège est-il symbolique ? À quel événement historique fait-il allusion ?
De quoi cette scène est-elle annonciatrice ?
▶ Pour réussir le commentaire : voir guide méthodologique.
▶ La question de l'homme : voir mémento des notions.
Les titres en couleurs et les indications entre crochets ne doivent pas figurer sur la copie.
Introduction
[Amorce] Dans la deuxième moitié du xix e siècle, la révolution industrielle bouleverse les rapports sociaux et suscitent des conflits dont les romanciers, conscients des enjeux et du rôle de la littérature, se font l'écho. Dans son cycle Les Rougon-Macquart, Zola est à la fois témoin de son époque et porte-parole des opprimés. [Présentation du texte] La dernière partie de son roman Germinal qui appartient à ce cycle relate la longue grève menée par des mineurs du Nord de la France. Le mouvement a tourné à la révolte et un cortège furieux « déboule » sous le regard affolé de bourgeois cachés. [Annonce des axes] Fidèle aux principes qu'il expose dans son Roman expérimental , Zola peint une scène réaliste spectaculaire, qui serait aisément transposable à l'écran [I] ; mais pour mieux émouvoir son lecteur, il dépasse l'objectivité qu'il revendique et communique à cet épisode le souffle de l'épopée. L'évocation de la révolte n'a plus seulement valeur documentaire : elle prend une dimension symbolique et même prophétique [II] .
I. Une scène spectaculaire, esthétiquement travaillée
1. le jeu sur les points de vue.
La description joue sur différents points de vue.
Au début, le cortège est décrit de façon objective comme s'il s'agissait d'un documentaire : « Les femmes avaient paru […], les hommes […] ».
Mais, au fur et à mesure, le tableau reflète le regard de l'auteur , puis celui , très subjectif, de ses « vrais » spectateurs : les bourgeois cachés derrière la porte d'une grange, implicitement désignés par le pronom impersonnel « on » (« on ne distinguait que… », « on voyait seulement… ») ; les termes péjoratifs qui qualifient les mineurs révèlent leur mépris : « affreuses », « furieux », « bandits »…
[Transition] Zola recourt aux ressources de tous les arts pour mieux frapper le lecteur.
2. Le regard du peintre
Avant d'être romancier, Zola rêvait d'être peintre. De cette première vocation, il garde une sensibilité artistique qui transparaît ici.
Comme sur une toile, il travaille les lignes , les volumes , « balaie » le cortège de son pinceau . Sont successivement décrits, avec un souci de l'équilibre des masses, les « femmes » (les mères, puis les « plus jeunes », enfin les « vieilles ») ; puis « les hommes… ».
Le tableau comporte différents plans : au premier plan, les mineurs, au second les bourgeois « Négrel » et « Mme Hennebeau » ; enfin, après une succession de plans picturaux choisis, le « soleil » couchant et la « route qui sembl[ait] charrier du sang » forment la toile de fond du tableau.
Zola choisit soigneusement ses couleurs et privilégie le rouge : les « rayons […] d'un pourpre sombre » du soleil couchant qui « ensanglant[ent] la plaine » enveloppent la scène d'une luminosité flamboyante , donnent du relief aux formes et contrastent avec les couleurs ternes des « culottes » « déteintes » ; les hommes forment une « uniformité terreuse », avec leurs « bouches noires ».
[Transition] Si Germinal a été de très nombreuses fois adapté au cinéma, c'est que Zola est un auteur particulièrement « cinématographique » avant l'heure.
3. Le regard d'un cinéaste avant l'heure
Après avoir placé le cortège au milieu de la scène, il déplace son « objectif » sur les bourgeois , dont il retranscrit les paroles affolées et dont les verbes « balbutia » et « dit entre ses dents » suggèrent les visages apeurés. Dans le dernier paragraphe, Zola revient alors aux mineurs, mais vus à travers les yeux des observateurs.
Le romancier varie les plans et effectue des va-et-vient entre plans d'ensemble et plans plus rapprochés : certains groupes sont décrits de plus près, avec notamment des gros plans marquants sur des « gorges », des « cous décharnés », des « têtes », des « bouches », des « mâchoires » ou, de façon encore plus saisissante, sur la « hache ».
La scène est animée. Les mouvements , violents, barbares, sauvages, sont signalés avec précision par des verbes d'action en cascade, dans des énumérations ou des accumulations qui traduisent le rythme effréné du défilé : « soulevaient, agitaient, brandissaient, déboulèrent, passa charrier, galoper ».
Zola a aussi recours aux ressources de la musique et anime la scène d'une « bande-son » tumultueuse : des hurlements (« hurlaient ») comme des cris de guerre précèdent le moment où éclate le chant de La Marseillaise, au milieu d'un bruit bestial confus (le « mugissement » de ce troupeau, le « claquement des sabots »). Zola ménage une pause, avec les répliques de bourgeois, transcrites au style direct, qui ressortent dans ce tohu-bohu comme des solos dans un morceau de musique. Il va jusqu'à jouer sur les sonorités suggestives : il mentionne les « g o r ges de gu e rr iè r es » ou un « mugissement c onfus, a cc ompagné par le cl a que ment… » Il s'agit là de véritables arrangements sonores.
[Transition] Zola s'inspire d'un événement réel pour composer une scène esthétiquement très travaillée mais, conscient que, pour frapper son lecteur, il faut dépasser l'aspect documentaire, il la transforme en une vision digne d'une épopée.
II. L'horreur et l'amplification d'une épopée
1. un réalisme effrayant.
Les détails physiologiques réalistes (« peau nue, nudités de femelles, enfanter, gorges gonflées, cordes de leurs cous décharnés […] [qui] semblaient se rompre […], trous des bouches noires […], mâchoires ») s'accompagnent de précisions effrayantes : les femmes ont les « cheveux épars, dépeignés », les « visages [sont] atroces », « les yeux brûlaient ». C'est un cortège de « bandits »…
Des termes violents accentuent le côté tragique de la scène, notamment les nombreux verbes (« agitaient, brandissaient, hurlaient, rompre, déboulèrent, débandade enragée, charrier »), le vocabulaire qui insiste sur la misère des mineurs (« meurt-de-faim », « décharnés », « en loques », « la faim », « souffrance »)… La fréquente référence au sang (« rouge », « pourpre sombre », « ensanglantaient », « charrier du sang ») ; tout cela donne une coloration funeste au cortège.
Enfin, la technique de description par touches des manifestants (« cous, bouches, yeux ») donne l'impression qu'ils sont disloqués en « morceaux d'hommes » .
[Transition] Ce réalisme – composante usuelle de l'épopée – correspond aux principes du naturalisme, mais Zola le dépasse et recourt dans sa description à d'autres ressources du registre épique.
2. Le « merveilleux »
Des images visionnaires (comparaisons et métaphores) transforment les manifestants et créent le merveilleux.
Les mineurs sont animalisés : les hommes deviennent des « bêtes fauves », les femmes ont des « nudités de femelles » ; déshumanisés, ils forment un troupeau au « mugissement » inquiétant, qui « galopent » et font résonner leur « sabots ».
Ailleurs, ils forment une vraie armée , une troupe de « bandits » hors-la-loi, composée aussi de « guerrières » dont les « bâtons » se sont transmués en « armes » et les « hache[s] » en « étendard ». Les « enfants » sont métamorphosés en objets symboliques, « drapeau[x] de deuil et de vengeance ».
Enfin, les hommes, « masse compacte qui roulait d'un seul bloc », semblent une masse minérale qui, par son « uniformité terreuse » rappelle la mine , ses dangers, et s'apparente à une force naturelle élémentaire.
3. Le souffle de l'épopée
Toute la scène est marquée par l' amplification épique .
Le mouvement ample des phrases qui rebondissent au gré des énumérations ou des accumulations, l'intensité du vocabulaire, le temps des verbes (le plus souvent à l'imparfait qui exprime la répétition ou au passé simple qui traduit des actions soudaines) donnent à la description un souffle épique .
Comme dans l'épopée, le héros de l'épisode est un personnage puissant , parce que collectif . Les pluriels (« les femmes, les hommes »), l'absence d'individualisation (les personnages ne sont pas nommés), les termes indéfinis (« quelques-unes », « d'autres », « des »), les noms collectifs généralisateurs (« masse compacte »), le chiffrage approximatif (« millier »), tout cela estompe toute individualité et donne l'impression que la force de ce héros, sujet de presque tous les verbes d'action, est décuplée . Face à lui, les bourgeois, nommés et bien identifiés, ont pour seule arme la parole (encore est-elle en sourdine) et semblent d'une présence dérisoire.
La rage des hommes s'étend à la nature entière et donne à la scène une dimension presque cosmique . Le décor naturel semble réglé au diapason de la révolte : « le soleil se couchait […] les derniers rayons ensanglantaient la plaine », « la route charri[e] du sang ».
4. Un texte symbolique et prophétique
La révolte, localisée dans les faits (Marchiennes est une petite commune), prend sous la plume de Zola une grandeur symbolique, chaque élément, significatif, est à interpréter.
Les « guenilles », « les coups décharnés », « les culottes déteintes, […] les tricots de laine en loques » sont, comme Zola l'indique à la fin du texte, autant d'images de « la faim », de la « souffrance » et de la misère des mineurs . La « hache », les « bâtons », la « guillotine », les références au « sang » traduisent leur détermination violente et « enragée » .
Plus généralement, la scène symbolise la lutte entre deux classes sociales : le symbolisme du rouge, la mention de la Marseillaise qui l'orchestre et de la « guillotine » sont des rappels historiques explicites de la Révolution de 1789.
Le soleil couchant donne au cortège un caractère prophétique effrayant, annonciateur de la fin d'une société . Mais le texte, éclairé par le souvenir de 1789 et par le titre du roman qui renvoie à la germination, ouvre aussi sur la perspective d'un monde nouveau, d'une renaissance après la « tuerie ».
[Synthèse] Ce passage est l'un des plus connus de Germinal , sans doute pour sa force d'évocation, le combat social qu'il représente et le travail artistique qu'il manifeste. [Ouverture] Il marque aussi un tournant du roman ; rien ne pourra plus être comme avant : la libération des mineurs est en marche. Zola espère que, par le biais de telles fresques visionnaires, il fera aussi progresser la société. Pour lui, comme pour Sartre, « l'écrivain engagé sait que la parole est action : il sait que dévoiler c'est changer […] Il a abandonné le rêve impossible de faire une peinture impartiale de la société et de la condition humaine » (Qu'est-ce que la littérature ?).
Pour lire la suite
Et j'accède à l'ensemble des contenus du site
Et je profite de 2 contenus gratuits
Academia.edu no longer supports Internet Explorer.
To browse Academia.edu and the wider internet faster and more securely, please take a few seconds to upgrade your browser .
Enter the email address you signed up with and we'll email you a reset link.
- We're Hiring!
- Help Center

Dissertation : Deux Conception du roman, le héros selon Émile Zola

Au XVIII ème siècle, un nouveau genre littéraire apparait, le naturalisme. Celui-ci éclipse peu à peu le romantisme, divisant alors les auteurs selon leurs idées sur la conception du roman…Émile Zola est un écrivain naturaliste et s'oppose à ses ainés romantiques comme Victor Hugo par exemple. Pour les naturalistes et comme l'a énoncé Zola, le roman doit être une description de la réalité, effectuée selon une démarche scientifique. Au contraire du romantisme qu'il considère comme une expression excessive des sentiments. C'est dans ce contexte que Zola déclare, dans Deux conceptions du roman : « Pour le naturaliste, le premier homme qui passe est un héros suffisant ». Cette déclaration porte le naturaliste comme seul vrai auteur, tout en le définissant. Toute cette déclaration est à l'extrême opposé de la conception précédente du roman, le romantisme, où le héros est idéalisé, hors du commun. La déclaration signifie que les héros n'existent pas dans le monde réel, que le héros naturaliste est décrit sans idéalisation, il est courant, presque banal.
Related Papers
Omar Nassur
Revue Brésil(s) [En ligne], n. 15 - Dossier Histoire et littérature
Leonardo Mendes , Pedro Paulo Catharina
Résumé: Nous présentons dans cet article une brève revue de l’historiographie canonique du naturalisme au Brésil dans laquelle nous avons identifié, depuis le moment de la première circulation de celui-ci jusqu’à présent, la constante caractérisation de l’esthétique comme « mineure ». Nous proposons donc une nouvelle cartographie du naturalisme au Brésil en mettant en lumière les positionnements à l’égard de l’esthétique de sous-groupes constitués d’écrivains dominants et dominés. Nous cherchons ainsi à revisiter la fiction naturaliste brésilienne sous un nouvel angle, pluriel et divers, capable d’embrasser d’autres auteurs et d’autres œuvres. Resumo: Nesse estudo, apresentamos uma breve revisão da historiografia canônica do naturalismo no Brasil na qual identificamos a constante caracterização da estética como « menor », desde o momento de sua primeira circulação até os dias de hoje. Propomos então uma nova cartografia do naturalismo no Brasil que expõe os posicionamentos em relação à estética de subgrupos formados por escritores dominantes e dominados. Desse modo, buscamos redefinir o mapa da ficção naturalista brasileira a partir de um novo ponto de vista plural e multifacetado, capaz de abarcar outros autores e obras.
Diana Georgiana
Sebastien Roldan
Joseph Jurt
Les analyses de réseaux ; réseaux ou champ ?, les degrés d'autonomie du champ artistique et du champ littéraire ; Zola et le champ artistique ; l'essor du champ scientifique ; la référence à Taine ; la préface à 'Thérèse Eaquin' ; le roman expérimental ; le groupe naturaliste ; 'Le Docteur Pascal
Genevieve De Viveiros
Barjonet Aurélie
Les Villes du symbolisme. Actes du colloque international organisé par Marc Quaghebeur et Marie-France Renard en collaboration avec l’Association Italiques (21-23 octobre 2003)
Laurence Brogniez
Publié dans: Les Villes du symbolisme. Actes du colloque international organisé par Marc Quaghebeur et Marie-France Renard en collaboration avec l’Association Italiques (21-23 octobre 2003), Bruxelles, Peter Lang/Archives et Musée de la Littérature, « Documents pour l’histoire des Francophonies/Europe », n°13, 2007, pp. 183-206.
Http Www Theses Fr
Filippo Bruschi
RELATED PAPERS
Fuat Boyacioğlu
Mémoire de recherche en littérature française
Auriane de Viry
Romain Peter
Przemyslaw Szczur
Yvan Cosson
Florian Bousquet
Shany Przendzik
Renaud Oulié
Didier COSTE
Mémoire de fin de stage
Romain Pigeaud
Quentin Fondu
Les Cahiers Naturalistes, nº 89, 61e année, 2015, p. 213-228.
Michael D Rosenfeld
Romain Courapied
Samuel Thévoz
Aude Leblond
ilyes Meghlaoui
Yrsa Þöll Gylfadóttir
Susana Salcedas
Claudia Bouliane
Clara Sadoun - Edouard
François Salaün
Editions Hermann, coll. Des morales et des oeuvres
Jean-Baptiste Amadieu
Emilie Sitzia
Tours et détours : écritures autobiographiques dans les littératures chinoise et japonaise au XXe siècle
Junko 淳子 Abe 阿部
Norme(s) et littérature au XIXe siècle. Actes des journées doctoriales 2010 de la SERD (dir. Mathilde Labbé et Landry Liébart)
Emilie Pézard
Léopold Pélagie
Cahiers naturalistes
Ursula Bähler
Elsa Courant , Romain Enriquez
Isabelle Hautbout
Quentin Courtois
Olivier Lahbib
éléonore reverzy
Romantisme, no.93, 1996, pp.53-63.
Michael Orwicz
L'Analisi Linguistica e Letteraria
Marisa Verna
Maria Chiara Gnocchi
- We're Hiring!
- Help Center
- Find new research papers in:
- Health Sciences
- Earth Sciences
- Cognitive Science
- Mathematics
- Computer Science
- Academia ©2024
- Petite section
- Moyenne section
- Grande section
- Première STMG
- Première ST2S
- Terminale STMG
- Terminale STI2D
- Terminale ST2S
- Mathématiques
- Enseignement moral et civique
- Physique-chimie
- Révisions Réviser une notion
- Lexique Trouver la définition d'un mot
- Se connecter
- Créer un compte
Germinal , de Zola
I. les caractéristiques de germinal, 1. un roman naturaliste, 2. le résumé de l'histoire, ii. les personnages, 1. étienne lantier, 2. bonnemort, 3. la maheude, 4. les bourgeois, iii. les thèmes principaux, 1. la parole, iv. les techniques, 1. comparaison et métaphore filée, 2. symboles, 3. antithèses, v. qui est zola .
Thérèse Raquin
Pour emile zola, thérèse raquin citations et analyse.
« Dans Thérèse Raquin , j’ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. Là est le livre entier. J’ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang, dépourvus de libre arbitre, entraînés à chaque acte de leur vie par les fatalités de leur chair ». Emile Zola, 1867 "Préface"
En décrivant Thérèse et Laurent (respectivement) comme « dominés par leurs nerfs et leur sang », Zola ne positionne pas ses personnages comme de simples types ou stéréotypes. Au contraire, il dessine une théorie contemporaine des comportements humains, qui stipulait que la personnalité et les « tempéraments » étaient déterminés par la composition physique avec l’entière prédominance du sang, des nerfs et d’autres substances. Toutefois, il est aussi possible de comprendre cette citation comme une réponse aux critiques. Tout au long de la « Préface », Zola rappelle les réactions scandalisées et les incompréhensions apparentes des premiers critiques de Thérèse Raquin. Mais si Thérèse Raquin peut-être résumé aussi efficacement que Zola le fait ici, l’incompréhension prolongée des critiques n’est-elle pas à la fois absurde et idiote ? Et depuis que ce roman est vraiment devenu une « étude » plus objective des affections « prédéterminées », de telles accusations médisantes ne semblent-elles inappropriées ?
« Elle resta l’enfant élevée dans le lit d’un malade ; mais elle vécut intérieurement une existence brûlante et emportée. Quand elle était seule, dans l’herbe, au bord de l’eau, elle se couchait à plat ventre comme une bête, les yeux noirs et agrandis, le corps tordu, près de bondir». Narrateur
Ce passage décrit l’enfance de Thérèse , qui pour de nombreuses années établit le modèle de sa vie adulte. Même si elle semble docile en apparence et dévouée à son cousin malade Camille, Thérèse à une vie intérieure qui est tout sauf calme. Elle est dotée d’une imagination folle et transpire l’agressivité. A l’âge adulte, Thérèse vit cette « double vie » de manière encore plus extrême ; elle affecte une passivité extrême et une obéissance en présence de Camille et de sa mère, mais elle s’adonne à sa nature vicieuse et animale dans ses ébats et ses complots meurtriers avec Laurent.
« Au fond, c’était un paresseux, ayant des appétits sanguins, des désirs très arrêtés de jouissances faciles et durables. Ce grand corps puissant ne demandait qu’à ne rien faire, qu’à se vautrer dans une oisiveté et un assouvissement de toutes les heures ». Narrateur
Ici, Zola explique un des points centraux de l’ironie du personnage de Laurent. Malgré son apparence de force physique et de vigueur sexuelle, le jeune homme ne souhaite rien de plus que d’abandonner ces capacités. Son amour, de plaisirs sans aucune exigence et toujours prévisibles, Laurent est en fait très semblable à Camille, qui est par ailleurs présenté comme le fleuret de Laurent. C’est une des nombreuses ironies de Thérèse Raquin : que deux personnalités si différentes, une "forte" et une "faible", puissent partager autant de valeurs.
« La nature et les circonstances semblaient avoir fait cette femme pour cet homme, et les avoir poussés l’un vers l’autre. À eux deux, la femme, nerveuse et hypocrite, l’homme, sanguin et vivant en brute, ils faisaient un couple puissamment lié. Ils se complétaient, se protégeaient mutuellement». Narrateur
Ce passage décrit Thérèse et Laurent à l’apogée de leur liaison. Mais même s’ils sont enivrés de passion, l’astucieux Zola avait conçu ce passage en résonnance avec d’autres parties du roman. Dans sa description de l’enfance de Thérèse, Zola déclare que son héroïne est « comme un animal », maintenant, Thérèse a trouvé l’amant parfait pour l’aider à libérer son côté animal. Mais ce passage préfigure également les changements et évolutions qui déstabiliseront les protagonistes. Ainsi, avant le meurtre de Camille, Thérèse et Laurent étaient capables de se protéger l’un l’autre ; après le crime ils ressentent seulement de la vulnérabilité lorsqu’ils sont ensemble.
« Et la pauvre mère voyait son fils roulé dans les eaux troubles de la Seine, le corps roidi et horriblement gonflé ; en même temps, elle le voyait tout petit dans son berceau, lorsqu’elle chassait la mort penchée sur lui. Elle l’avait mis au monde plus de dix fois, elle l’aimait pour tout l’amour qu’elle lui témoignait depuis trente ans. Et voilà qu’il mourait loin d’elle, tout d’un coup, dans l’eau froide et sale comme un chien ». Narrateur
Les souvenirs de Mme Raquin distillent une terrible ironie du sort. Camille n’est pas décédé lorsqu’il était affaibli ni quand il était aux portes de la mort, mais bien plus tard après être sorti de son berceau (quand la mort tentait encore et encore « de l’emporter ») et d’avoir à peine eu le temps de devenir un jeune homme indépendant. Mme Raquin constate ce sombre coup du sort, mais ce qu’il l’émeut le plus est la solitude dans la mort de Camille et l’horreur de son destin : « son corps rigide et terriblement gonflé ». Ainsi, Camille semble torturé et impuissant, mais son cadavre reviendra en force torturer ses deux assassins, Laurent et Thérèse.
« Pendant plus d’une année, Thérèse et Laurent portèrent légèrement la chaîne rivée à leurs membres, qui les unissait ; dans l’affaissement succédant à la crise aiguë du meurtre, dans les dégoûts et les besoins de calme et d’oubli qui avaient suivi, ces deux forçats purent croire qu’ils étaient libres, qu’un lien de fer ne les liait plus ». Narrateur
« Pendant plus d’un an, Thérèse et Laurent portèrent avec légèreté la chaîne qui était attachée à leurs membres, les liant ensemble. Dans l’effondrement mental qui suivit la crise aiguë du meurtre, dans les sentiments de dégoût et le besoin de calme et d’oubli qui suivit, les deux prisonniers purent imaginer qu’ils étaient libres et qu’aucun lien de fer ne les unissait ». Narrateur.
A ce moment de l’histoire, Thérèse et Laurent ne sont pas encore mariés et n’ont pas succombé au désespoir, à l’enfermement ni au désarroi que leur mariage leur apportera. Parce qu’ils sont physiquement séparés la plupart du temps, ils peuvent maintenir l’illusion d’une certaine liberté. Le narrateur omniscient de Zola est explicite à ce sujet : ce n’est qu’une illusion. Il y a très certainement de l’anxiété dans les liens entre Thérèse et Laurent, mais en réalité, ils n’ont que peu liberté pour se rebeller contre leur captivité ou encore pour échapper à la dynamique autodestructrice qui a commencé avec le crime de Camille.
« Et chaque semaine ramena un jeudi soir, chaque semaine réunit une fois autour de la table ces têtes mortes et grotesques qui exaspéraient Thérèse jadis. La jeune femme parla de mettre ces gens à la porte ; ils l’irritaient avec leurs éclats de rire bêtes, avec leurs réflexions sottes. Mais Laurent lui fit comprendre qu’un pareil congé serait une faute ; il fallait autant que possible que le présent ressemblât au passé ; il fallait surtout conserver l’amitié de la police, de ces imbéciles qui les protégeaient contre tout soupçon ». Narrateur.
Dans un roman où les personnages principaux changent de manière si radicale, les personnages mineurs sont curieusement incapables de la moindre évolution. Le vieux Michaud, Grivet, et le reste des invités des soirées du jeudi étaient insupportables pour Thérèse dès le départ et le resteront jusqu’à la fin. L’ironie est que plutôt que désirer le départ de ces « imbéciles » avec leurs « éclats de rire stupides et leurs remarques idiotes », Thérèse est forcée de les endurer afin de ne pas souffrir d’un sort pire : la découverte de leur crime. Aussi, les invités du jeudi n’ont pas besoin de faire quelque chose de particulier pour aider Thérèse et Laurent à survivre ; encore une autre ironie, les Michaud et Grivet se trouvent en fait utiles en restant simplement d’ennuyeux et inutiles parasites.
« Une rage sourde s’était emparée de Laurent. Il creva la toile d’un coup de poing, en songeant avec désespoir à son grand tableau. Maintenant il n’y fallait plus penser ; il sentait bien que, désormais, il ne dessinerait plus que la tête de Camille, et, comme le lui avait dit son ami, des figures qui se ressembleraient toutes feraient rire ». Narrateur.
Techniquement, la seule personne que Laurent peint au cours du roman est Camille. Le premier tableau que Laurent tente d’exécuter est le portrait du fils choyé de Mme Raquin, puis, à chaque fois qu’il revient à sa peinture, il trouve que chaque visage créé est hanté par l’homme noyé. Même les chats et les chiens de Laurent ressemblent étrangement au cadavre de Camille. Cette situation peut-être perçue comme comique ou tragique. L’ami peintre de Laurent, qui regarde tout cela de loin et son manque de connaissance de la vie de Laurent, considère avec humour ; Laurent se voit piégé dans une tragédie de talent gâché et d’obsession dont il ne peut s’échapper.
« La pensée du suicide lui devint lourde, lorsqu’elle songea tout d’un coup à l’ignorance qu’elle emporterait dans la tombe ; là, au milieu du froid et du silence de la terre, elle dormirait, éternellement tourmentée par l’incertitude où elle serait du châtiment de ses bourreaux. Pour bien dormir du sommeil de la mort, il lui fallait s’assoupir dans la joie cuisante de la vengeance, il lui fallait emporter un rêve de haine satisfaite, un rêve qu’elle ferait pendant l’éternité ». Narrateur.
L'histoire atteint ce stade ultime lorsque Mme Raquin a découvert le meurtrier et a renoncé à ses anciennes croyances en Dieu et la bonté. En effet, elle a réalisé que « la réalité de la vie telle qu’elle était, embourbée dans un bourbier de passion. Dieu était mauvais". Il est néanmoins possible de lire ce passage en référence avec « l’éternité », impliquant une sorte de vie dans l’au-delà. Mais il ne s’agit plus ici de la vie après la mort des Chrétiens où la vertu est récompensée ; c’est un état approchant les limites du néant ou de « l’insensibilité », un état que Mme Raquin ne ressentira que si elle réussit à venger Camille.
« Et brusquement Thérèse et Laurent éclatèrent en sanglots. Une crise suprême les brisa, les jeta dans les bras l’un de l’autre, faibles comme des enfants. Il leur sembla que quelque chose de doux et d’attendri s’éveillait dans leur poitrine. Ils pleurèrent, sans parler, songeant à la vie de boue qu’ils avaient menée et qu’ils mèneraient encore, s’ils étaient assez lâches pour vivre. Alors, au souvenir du passé, ils se sentirent tellement las et écœurés d’eux-mêmes, qu’ils éprouvèrent un besoin immense de repos, de néant ». Narrateur.
Ici, Thérèse et Laurent ont tout juste découvert qu’ils avaient le même projet d’assassinat ; Thérèse tient son couteau et Laurent prépare le verre d’eau contenant le poison. Ils ont vraiment atteint cette extrémité, non pas parce qu’ils ont de forts désirs ou sont en compétition, mais parce qu’ils sont trop faibles pour rester dans cet état. Les deux assassins semblent comprendre et partager cette faiblesse, et cette réalisation qui finit par les réconcilier. Pour une fois, “Il leur sembla que quelque chose de doux et d’attendri » et non quelque chose de désagréable et détestable, les conduit enfin l’un vers l’autre.
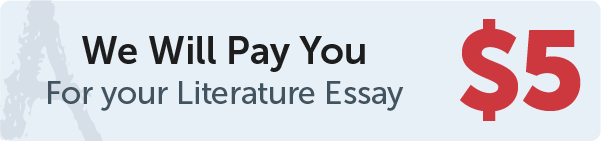
Questions et Réponses par Thérèse Raquin
La section Question et Réponse par Thérèse Raquin Recours pour faire des réponses, trouver des réponses et discuter l'œuvre
Guide d'étude pour Thérèse Raquin
Thérèse Raquin study guide contains a biography of Emile Zola, literature essays, quiz questions, major themes, characters, and a full summary and analysis.
- A propos de Thérèse Raquin
- Thérèse Raquin Résumé
- Liste des Personnages
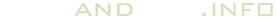
Current time by city
For example, New York
Current time by country
For example, Japan
Time difference
For example, London
For example, Dubai
Coordinates
For example, Hong Kong
For example, Delhi
For example, Sydney
Geographic coordinates of Bratsk, Irkutsk Oblast, Russia
City coordinates
Coordinates of Bratsk in decimal degrees
Coordinates of bratsk in degrees and decimal minutes, utm coordinates of bratsk, geographic coordinate systems.
WGS 84 coordinate reference system is the latest revision of the World Geodetic System, which is used in mapping and navigation, including GPS satellite navigation system (the Global Positioning System).
Geographic coordinates (latitude and longitude) define a position on the Earth’s surface. Coordinates are angular units. The canonical form of latitude and longitude representation uses degrees (°), minutes (′), and seconds (″). GPS systems widely use coordinates in degrees and decimal minutes, or in decimal degrees.
Latitude varies from −90° to 90°. The latitude of the Equator is 0°; the latitude of the South Pole is −90°; the latitude of the North Pole is 90°. Positive latitude values correspond to the geographic locations north of the Equator (abbrev. N). Negative latitude values correspond to the geographic locations south of the Equator (abbrev. S).
Longitude is counted from the prime meridian ( IERS Reference Meridian for WGS 84) and varies from −180° to 180°. Positive longitude values correspond to the geographic locations east of the prime meridian (abbrev. E). Negative longitude values correspond to the geographic locations west of the prime meridian (abbrev. W).
UTM or Universal Transverse Mercator coordinate system divides the Earth’s surface into 60 longitudinal zones. The coordinates of a location within each zone are defined as a planar coordinate pair related to the intersection of the equator and the zone’s central meridian, and measured in meters.
Elevation above sea level is a measure of a geographic location’s height. We are using the global digital elevation model GTOPO30 .
Bratsk , Irkutsk Oblast, Russia
Persistent organic pollutants in the natural environments of the city of Bratsk (Irkutsk Oblast): Levels and risk assessment
- Degradation, Rehabilitation, and Conservation of Soils
- Published: 06 November 2014
- Volume 47 , pages 1144–1151, ( 2014 )
Cite this article

- E. A. Mamontova 1 ,
- E. N. Tarasova 1 &
- A. A. Mamontov 1
74 Accesses
3 Citations
Explore all metrics
The contents of persistent organic pollutants (POPs)—polychlorinated biphenyls (PCBs) and organochlorine pesticides (OCPs)—in the natural environments of an industrial city (Bratsk) of Irkutsk oblast have been studied. Features of the spatial and seasonal distribution of the PCBs and OCPs in the soils and the atmospheric air have been revealed. The structure of the homological and congeneric composition of the PCBs in the soils and the atmospheric air has been shown. Parameters of the carcinogenic and noncarcinogenic risks for human health from the impact of the PCBs and OCPs present in the soils and the atmospheric air have been determined.
This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.
Access this article
Price includes VAT (Russian Federation)
Instant access to the full article PDF.
Rent this article via DeepDyve
Institutional subscriptions
Similar content being viewed by others

Polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in the air-soil system in the South of the Russian Far East
The effect of long-range atmospheric transport of organochlorine compounds by soil studies from mongolia to the arctic.

Occurrence of dioxin-like POPs in soils from urban green space in a metropolis, North China: implication to human exposure
Atlas. The Irkutsk Region: Ecological Conditions of the Development (Moscow, Irkutsk, 2004) [in Russian].
Ts. I. Bobovnikova, F. I. Khakimov, A. Yu. Popova, D. B. Orlinskii, A. S. Kerzhentsev, N. R. Deeva, I. V. Priputina, L. B. Alekseeva, G. V. Chernik, G. A. Pleskatchevskaya, A. V. Shalanda, “The impact of the condenser plant on the environmental contamination of Serpukhov with polychlorinated biphenyls,” in Polychlorinated Byphenyls. Supertoxicants of the XXI Century , No. 5 (VINITI, Moscow, 2000), pp. 87–103 [in Russian].
Google Scholar
E. S. Brodskii, A. A. Shelepchikov, D. B. Feshin, E. S. Efimenko, G. I. Agapkina, “Distribution of polychlorinated biphenyls’ congeners in soils of Moscow,” Vestn. Mosk. Univ., Ser. 17: Pochvoved., No 2, 35–40 (2012).
R. V. Galiulin and R. A. Galiulina, “Ecogeochemical assessment of the “reprints” of persistent organochlorine pesticides in the soil-surface water system,” Agrokhimiya, No. 1, 52–56 (2008).
M. I. Gerasimova, M. N. Stroganova, N. V. Mozharova, and T. V. Prokof’eva, Anthropogenic Soils: Genesis, Geography, and Reclamation (Oikumena, Smolensk, 2003) [in Russian].
Hygienic Norms for Concentrations of Pesticides in the Environmental Objects (Fed. Ts. Gosprirodnadzor, Minzdrav RF, Moscow, 2003) [in Russian].
State Report on the Environmental Protection and State of the Environment of Irkutsk Oblast in 2003 (Oblmashinform, Irkutsk, 2004) [in Russian].
State Report on the Environmental Protection in Irkutsk Oblast in 2011 (Forvard, Irkutsk, 2012) [in Russian].
State Report on the Environmental Protection and State of the Environment of Irkutsk Oblast in 2011 (Min. prirod. resurs. RF, Moscow, 2012) [in Russian].
State Report on the Ecological Situation in Irkutsk Oblast in 1993 (VS AGP, Irkutsk, 1994) [in Russian].
L. P. Ignat’eva, Extended Abstract of Doctoral Dissertation in Biology (Irkutsk, 1997).
Climate of Bratsk , Ed. by Ts. A. Shver and V. N. Babichenko (Gidrometeoizdat, Leningrad, 1985) [in Russian].
A. V. Konoplev, V. A. Nikitin, D. P. Samsonov, G. V. Chernik, A. M. Rychkov, “Polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in the atmosphere of Russian Arctic in the Far East,” Meteorol. Gidrol., No. 7, 38–44 (2005).
Control of the Chemical and Biological Parameters of the Environment (Ekol. Ts. Soyuz, St. Petersburg, 1998) [in Russian].
T. I. Kukharchyk, S. V. Kakareka, V. S. Khomich, P. V. Kurman, E. N. Voropai, “Polychlorinated biphenyls in soils of Belarus: sources, contamination levels, and problems of study,” Eur. Soil Sci. 40 (5), 485–492 (2007).
Article Google Scholar
E. A. Mamontova, E. N. Tarasova, M. I. Kuz’min, B. Z. Borisov, A. P. Bul’ban, S. I. Levshina, E. V. Lepskaya, O. D. Tregubov, S. G. Yurchenko, A. A. Mamontov, “Distribution of persistent organic pollutants in the soil-atmosphere system of Siberia and the Far East,” Geoekologiya, No. 4, 328–338 (2014).
E. A. Mamontova, E. N. Tarasova, A. A. Mamontov, M. I. Kuz’min, B. Z. Borisov, A. P. Bul’ban, S. G. Yurchenko, E. V. Lepskaya, S. I. Levshina, O. D. Tregubov, “Persistent organic pollutants in atmospheric air of some territories of Siberia and the Far East of Russia,” Geogr. Prir. Resur., No. 4, 40–47 (2012).
State of the Environment and Environmental Pollution in the Russian Federation in 2008 , Ed. by Yu. A. Izrael (Rosgidromet, Moscow, 2009) [in Russian].
State of the Environment and Environmental Pollution in the Russian Federation in 2009 , Ed. by Yu. A. Izrael, G. M. Chernogaeva, V. I. Egorov, A. S. Zelenov, and Yu. V. Peshkov (Rosgidromet, Moscow, 2009) [in Russian].
Polychlorinated Biphenyls in the Baikal Region: Sources, Distant Transfer, and Risk Assessment (Izd. Inst. Geogr. SO RAN, Irkutsk, 2005) [in Russian].
Guidelines for Human Health Risk Assessment upon the Impact of Chemical Contaminants (Minzdrav Rossii, Moscow, 2004) [in Russian].
M. F. Savchenkov and L. P. Ignat’eva, Hygiene of the Application of Pesticides in Siberia (Izd. Irkutsk Gos. Univ., Irkutsk, 1994) [in Russian].
http://chm.pops.int/TheConvention/Overview/tabid/3351/Default.aspx .
N. N. Surnina, Yu. A. Anokhin, V. P. Kiryukhin, and A. V. Mitroshkov, “Atmospheric contamination in the Angara and Baikal regions with polychlorinated biphenyls,” in Monitoring of Lake Baikal (Gidrometeoizdat, Leningrad, 1991), pp. 54–59 [in Russian].
E. N. Tarasova, E. A. Mamontova, A. V. Goreglyad, L. L. Tkachenko, A. A. Mamontov, “Persistent organic pollutants in atmospheric air of the northern Khubsugul region,” in Lake Ecosystems: Biological Processes, Anthropogenic Transformation, and Water Quality (Izd. Ts. BGU, Minsk, 2011), pp. 186–187 [in Russian].
Yu. A. Treger, “Persistent organic pollutants. problems and solutions,” Vestn. MITKhT 6 (5), 87–97 (2011).
http://irkutskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/irkutskstat/ru/statistics/population/ .
I. Ya. Shakhtamirov and Z. K. Amirova, “Atmospheric air and soil cover contamination with persistent organic pollutants in the residential zone of Groznyi,” Ekolog. Urbanizir. Territ., No. 4, 88–93 (2011).
A. A. Shelepchikov, E. S. Brodskii, D. B. Feshin, V. G. Zhil’nikov, E. Ya. Mir-Kadyrova, S. P. Balashova, “Polychlorinated dibenzo-p-dioxins, dibenzofurans, and biphenyls in soils of Moscow,” Eur. Soil Sci. 44 (3), 286–296 (2011).
R. E. Bailey, “Global hexachlorobenzen emissions,” Chemosphere 43 , 167–182 (2001).
Canadian Council of Ministers of the Environment, Canadian Environmental Quality Guidelines (Winnipeg, 1999).
L. Dusek and M. Tesarova, “Influence of polychlorinated biphenyls on microbial biomass and its activity in grassland soil,” Biol. Fertil. Soil, No. 22, 243–247 (1996).
J. N. Hogarh, N. Seike, Y. Kobara, A. Habib, J.-J. Nam, J. -S. Lee, Q. Li, X. Liu, J. Li, G. Zhang, S. Masunaga, “Passive air monitoring of PCBs and PCNs across East Asia: A comprehensive congener evaluation for source characterization,” Chemosphere 86 , 718–726 (2012).
V. Ivanov and E. Sandell, “Characterization of polychlorinated biphenyl isomers in sovol and trichlorodiphenyl formulations by high-resolution gas chromatography with electron capture detection and high-resolution gas chromatography — mass spectrometry techniques,” Environ. Sci. Technol. 26 , 2012–2017 (1992).
A. A. Mamontov, E. A. Mamontova, E. N. Tarasova, M. I. Kuzmin, M. S. McLachlan, “Persistent organic pollutants in soil and snow from the Lake Baikal region,” Organohalog. Compounds 66 , 1327–1332 (2004).
E. A. Mamontova, E. N. Tarasova, and M. S. McLachlan, “Tracing the sources of PCDD/Fs and PCBs to Lake Baikal,” Environ. Sci. Technol. 34 (5), 741–747 (2000).
E. A. Mamontova, M. I. Kuzmin, E. N. Tarasova, and M. Yu. Khomutova, “The investigation of PCBs and OCPs in air in the Irkutsk region (Russia) using passive air sampling,” Vestn. KazNU. Ser. Khimich., No. 4, 209–213 (2010).
E. A. Mamontova, A. A. Mamontov, E. N. Tarasova, M. I. Kuzmin, D. Ganchimeg, M. Yu. Khomutova, O. Gombosuren, and E. Ganjuurjav, “Polychlorinated biphenyls in surface soil in urban and background areas of Mongolia,” Environ. Pollut. 182 , 424–429 (2013).
S. N. Meijer, W. A. Ockenden, A. Sweetman, K. Brei- vik, J. O. Grimalt, K. C. Jones, “Global distribution and budget of PCBs and HCBs in background surface soils: implication for sources and environmental processes,” Environ. Sci. Technol. 37 , 667–672 (2003).
K. Pozo, T. Harner, S. Lee, F. Wania, D. C. G. Muir, K. C. Jones, “Seasonally resolved concentrations of persistent organic pollutants in the global atmosphere from the first year of the GAPS study,” Environ. Sci. Technol. 43 , 796–803 (2009).
M. Shoeib and T. Harner, “Characterization and comparison of three passive air samplers for persistent organic pollutants,” Environ. Sci. Technol. 36 , 4142–4151 (2002).
T. Takasuga, K. Senthilkumar, T. Matsumura, K. Shiozaki, S. Sakai, “Isotope dilution analysis of polychlorinated biphenyls (PCBs) in transformer oil and global commercial PCB formulations by high resolution gas chromatography-high resolution mass spectrometry,” Chemosphere, No. 62, 469–484 (2006).
S. Tao, W. Liu, Y. Li, Y. Yang, Q. Zuo, B. Li, J. Cao, “Organochlorine pesticides contaminated surface soil as reemission source in the Haihe Plain, China,” Environ. Sci. Technol. 42 , 8395–8400 (2008).
X. Zhao, M. Zheng, B. Zhang, Q. Zhang, W. Liu, “Evidence for the transfer of polychlorinated biphenyls, polychlorinated dibenzo-p-dioxins, and polychlorinated dibenzofurans from soil into biota,” Sci. Total Environ. 368 (2–3), 744–752 (2006).
Download references
Author information
Authors and affiliations.
Vinogradov Institute of Geochemistry, Siberian Branch, Russian Academy of Sciences, ul. Favorskogo 1a, Irkutsk, 664033, Russia
E. A. Mamontova, E. N. Tarasova & A. A. Mamontov
You can also search for this author in PubMed Google Scholar
Corresponding author
Correspondence to E. A. Mamontova .
Additional information
Original Russian Text © E.A. Mamontova, E.N. Tarasova, A.A. Mamontov, 2014, published in Pochvovedenie, 2014, No. 11, pp. 1356–1364.
Rights and permissions
Reprints and permissions
About this article
Mamontova, E.A., Tarasova, E.N. & Mamontov, A.A. Persistent organic pollutants in the natural environments of the city of Bratsk (Irkutsk Oblast): Levels and risk assessment. Eurasian Soil Sc. 47 , 1144–1151 (2014). https://doi.org/10.1134/S1064229314110076
Download citation
Received : 09 January 2014
Published : 06 November 2014
Issue Date : November 2014
DOI : https://doi.org/10.1134/S1064229314110076
Share this article
Anyone you share the following link with will be able to read this content:
Sorry, a shareable link is not currently available for this article.
Provided by the Springer Nature SharedIt content-sharing initiative
- polychlorinated biphenyls
- organochlorine pesticides
- Find a journal
- Publish with us
- Track your research

IMAGES
VIDEO
COMMENTS
_ Entraînement à l'Épreuve Anticipée de Français : dissertation littéraire Œuvres au programme de mes classes de Première Générale : Albert Camus, L'Étranger François Mauriac : Thérèse Desqueyroux Pour la méthodologie de la dissertation, voir ce support de cours. - Dissertation littéraire Sujet corrigé Bruno Rigolt Rappel du sujet : Émile Zola dans Le Roman expérimental…
Si tu envisages la dissertation au bac de français, tu es au bon endroit. Tu trouveras sur cette page : Des exemples de sujets de dissertation sur chaque œuvre au programme. Un exemple de dissertation entièrement rédigée selon les exigences du bac de français. Pour bien traiter ces sujets, aide-toi de ma méthode de la dissertation qui te ...
Cependant, pendant longtemps le Réalisme et le Naturalisme restent indifférenciés. Le Naturalisme s'inscrit dans la lignée de la biologie qui connaît un véritable essor. C' est une théorie qui considère que l'art doit être une reproduction de la nature, Le terme est repris par Zola et modifié sous l'influence de Claude Bernard.
Sujet et correction d'une dissertation pour l'écrit du bac de français. écrit du bac de français 2024 ... Sujets corrigés. Vous êtes ici : La dissertation > Sujets corrigés. La dissertation pour l'écrit du bac de français Sujet corrigé - Sujet 1 ... Zola anime et illustre le courant naturaliste avec la fresque des Rougon Macquart et ...
PLAN DE LA DISSERTATION : La description semble souvent interrompre le récit de manière arbitraire. Elle est pourtant l'outil indispensable de l'investigation naturaliste du milieu, mais elle ne se limite pas au rôle scientifique que lui assigne ici Zola. I - LA DESCRIPTION NATURALISTE : UNE NÉCESSITÉ DE SAVANT. Un indicateur du milieu.
Texte intégral de La curée - Zola (648 ko) Lecture audio de La Curée - Zola. Voici les différentes fiches de révision sur La Curée : - Incipit. - Chapitre I. - Chapitre I - fin. - Chapitre II. - Chapitre III. - Chapitre III - fin.
Le réalisme que défend et illustre Zola est dans un entre-deux : il n'emprunte en aucune façon la voie du réductionnisme schématique. Il rend au contraire hommage à une réalité conçue non pas comme un espace-temps inaltérable et une pure extériorité, mais plutôt comme un milieu.L'idée de raconter l'« histoire », fût-elle « naturelle et sociale », « d'une famille ...
D - La culture populaire et le travail du style dans L'Assommoir 1. Ethnographie et linguistique. Cette dernière fête achève l'exploration de la culture populaire qu'a tentée Zola dans un roman de l'alcoolisme qui est aussi une étude ethnographique : on y apprend comment on se marie, comment on vit et comment on meurt dans le petit peuple des faubourgs.
Fils de François Zola et d'Emilie-Aurélie Zola (née Aubert), Emile Zola naît le 2 avril 1840 à Paris, au 10 de la rue Saint-Joseph. Cette filiation est importante car ses parents occupent ...
Fiches de révisions : Résumés d'œuvres Zola - Bac Français. La bête humaine. Au bonheur des Dames. L'Assommoir. La Curée. Polémiste célèbre - notamment à cause de son article J ...
Introduction. J'accuse ! est le titre d'une lettre ouverte écrite en 1898 par Émile Zola, écrivain naturaliste engagé dans la lutte pour réhabiliter l'officier Alfred Dreyfus, injustement condamné par les tribunaux de l'armée française pour traîtrise envers sa patrie. Dans cette lettre adressée au président Félix Faure, Zola ...
Emile Zola, Germinal - Annale corrigée de Français 1re ES sur Annabac.com, site de référence. Aller au contenu principal 🎁 Dernière ligne droite ! -25% avec le code JEVEUXMONBAC2024 ! ...
Dissertation : Deux Conception du roman, le héros selon Émile Zola Au XVIIIème siècle, un nouveau genre littéraire apparait, le naturalisme. Celui-ci éclipse peu à peu le romantisme, divisant alors les auteurs selon leurs idées sur la conception du roman…Émile Zola est un écrivain naturaliste et s'oppose à ses ainés romantiques ...
Le naturalisme, avec Zola comme figure de proue, s'inscrit dans le prolongement de ce réalisme militant. Il entend dresser le constat de la subordination de l'homme à son milieu, en décrivant la réalité humaine partout où on la trouve : le roman naturaliste explore donc les couches populaires (L'Assommoir, 1877), le prolétariat (Germinal, 1885), les milieux de la prostitution parisienne ...
Thérèse Raquin Questions de Dissertation. 1. Qui est le plus à blâmer pour le meurtre de Camille, Thérèse ou Laurent ? Le cas de Laurent est assez simple, c'est lui qui étrangle Camille, et il ne ressent aucune des angoisses et des doutes que Thérèse éprouve sur les lieux du meurtre. Mais il y a aussi de bons arguments incriminants ...
Émile Zola, (born April 2, 1840, Paris, France—died Sept. 28, 1902, Paris), French novelist and critic. ... or critical literary composition usually much shorter and less systematic and formal than a dissertation or thesis and usually dealing with its subject from a limited and often personal point of view. Some early treatises—such as ...
Le résumé de l'histoire. Germinal fait partie d'un ensemble de vingt romans, intitulé les Rougon-Macquart : Histoire naturelle et sociale d'une famille sous le second Empire. L'action se déroule de mars 1866 à avril 1867. • Première partie : Étienne Lantier se fait embaucher, à Montsou, par la Compagnie qui exploite les mines de charbon.
C'est une des nombreuses ironies de Thérèse Raquin : que deux personnalités si différentes, une "forte" et une "faible", puissent partager autant de valeurs. « La nature et les circonstances semblaient avoir fait cette femme pour cet homme, et les avoir poussés l'un vers l'autre. À eux deux, la femme, nerveuse et hypocrite, l ...
Document n°3 Classe de 2nde U Séquence II « L'Affaire Thérèse Raquin » Questions que les élèves aimeraient poser à un lecteur du roman Thérèse Raquin d'Emile Zola Ces questions serviront de base à notre étude de l'oeuvre ; elles pourront être utilisées dans l'écrit final (l'interview du réalisateur).
Artyomovsky (Артёмовский) Balakhninsky (Балахнинский) Kropotkin (Кропоткин) Mamakan (Мамакан) Angarsky (Ангарский) district. urban okrug. 25 203.
Geographic coordinates of Bratsk, Irkutsk Oblast, Russia in WGS 84 coordinate system which is a standard in cartography, geodesy, and navigation, including Global Positioning System (GPS). Latitude of Bratsk, longitude of Bratsk, elevation above sea level of Bratsk.
The contents of persistent organic pollutants (POPs)—polychlorinated biphenyls (PCBs) and organochlorine pesticides (OCPs)—in the natural environments of an industrial city (Bratsk) of Irkutsk oblast have been studied. Features of the spatial and seasonal distribution of the PCBs and OCPs in the soils and the atmospheric air have been revealed. The structure of the homological and ...
This article discusses recent changes in the development of industrial production in Irkutsk oblast from 2010 to 2019. Industry is the basic component in the economic complex; it provides about half of the region's gross added value and is characterized by a multi-sectoral structure formed primarily on the basis of using natural resources and cheap electricity.